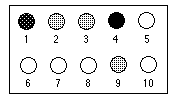
Formation continue et obligation
de compétences dans le métier
d’enseignant
Philippe Perrenoud
Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation
Université de Genève
1997
I. Formation continue et développement de compétences professionnellesIII. L’obligation de compétences : une évaluation en quête d’acteurs
IV. Rendre compte, oui, mais comment et à qui ?
Les quatre chapitres de ce texte reprennent quatre articles complémentaires publiés dans l’Éducateur (Perrenoud, 1996 a, b, c et d). Le premier propose d’orienter plus explicitement la formation continue vers la construction de compétences professionnelles cohérentes en regard de l’évolution du métier d’enseignant et du système éducatif. Le second situe l’évaluation des enseignants entre une impossible obligation de résultats et une stérile obligation de procédure et propose une obligation de compétence. Le troisième chapitre analyse des ambivalences et des réticences des intéressés, qui font de l’évaluation des enseignants une évaluation en quête d’acteurs. Le dernier chapitre propose quelques dispositifs généraux et spécifiques de professionnalisation, d’observation formative et de contrôle.
Dès l’année scolaire 1996-97, dans l’enseignement primaire genevois, la formation professionnelle continue s’organisera pour une large part selon dix domaines prioritaires, chacun comprenant plusieurs compétences de base. Par exemple, le domaine " Travailler en équipe " recouvrira cinq compétences de base, dont " Gérer des crises ou des conflits entre personnes ". Un tel référentiel de compétences (dont on trouvera le détail dans le tableau) devrait être intelligible et peut-être utile en lui-même. Il est toutefois préférable de le situer dans un contexte et d’en rappeler la genèse.
Il représente une étape d’une démarche conduite par la Commission de la formation, commission paritaire instituée dans l’enseignement primaire genevois pour débattre de l’ensemble des problèmes de formation, composée de six représentants de l’administration scolaire (direction, inspection et services) et de six représentants de la Société pédagogique genevoise (enseignants et formateurs). Aux travaux de la Commission sont associés deux professeurs de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, puisque, dès 1996, la formation initiale des enseignants primaires est à Genève entièrement confiée à l’Université, qui en assume le tiers depuis les années 1930 et qui contribue par ailleurs, depuis longtemps, à la formation continue des enseignants. C’est à ce titre que je vais tenter de présenter une approche par compétences qui se développe tant en formation initiale qu’en formation continue.
Des recyclages à la formation continue
La formation continue des enseignants est en voie d’institutionnalisation. Elle cherche encore sa place. Dans les cantons romands, elle a pris souvent, dans un premier temps, une double allure :
Les recyclages obligatoires sont progressivement abandonnés. Ils ne sont plus dans l’esprit du temps. On ne peut en même temps parier sur la professionnalisation, les projets d’école, la responsabilisation et convoquer les enseignants en formation par un ordre de marche ; on ne peut plaider pour la prise en compte des différences entre élèves et ignorer les différences entre enseignants ; les recyclages standards étaient trop élémentaires pour certains et nettement insuffisants pour d’autres.
Quant au perfectionnement, il respecte la liberté de choix de chacun, mais laisse en revanche le système éducatif assez démuni quant à l’articulation nécessaire entre politique de l’éducation et formation continue. Par ailleurs, le libre choix produit partout un phénomène maintenant connu, qu’on peut caricaturer de la sorte : le quart le plus actif du corps enseignant consomme les trois quarts de la formation, alors que la moitié la moins concernée n’y participe pratiquement pas !
Les systèmes éducatifs sont donc à la recherche d’un moyen terme entre autoritarisme et laisser-faire, d’une politique de la formation continue incitatrice et orientée par des objectifs à long terme, sans être coercitive.
Cela passe par plusieurs avancées :
1. Une intégration de la formation continue à la législation et aux cahiers des charges des enseignants, sous une double forme :
2. Une gestion paritaire de la formation continue entre administration scolaire et associations professionnelles, ou au minimum des concertations sur les grandes orientations.
3. Le développement de la formation continue en établissement, en liaison avec un projet (de recherche-action, d’innovation ou de formation).
4. La création d’un corps de formateurs et de services assurant des offres régulières de formation continue sur des thèmes pas trop éloignés des pratiques professionnelles, des programmes, des fonctionnements spécifiques de l’école.
5. Une articulation avec la formation initiale, autrement dit une forme de continuité, de suivi, chacune s’adaptant aux évolution de l’autre et du système.
Le Canton de Genève a grosso modo franchi ces étapes, à sa manière, en tout cas pour ce qui concerne l’enseignement primaire. Il en aborde aujourd’hui une nouvelle : lier plus fortement la formation continue à un référentiel de compétences et une politique de l’éducation.
Formation et compétences
L’enjeu est d’abord de mettre explicitement la formation continue au service de compétences professionnelles. Cela va-t-il sans dire ? Ce n’est pas sûr. Certaines des offres de recyclage ou de perfectionnement élargissent la culture, l’information ou les talents artisanaux ou techniques des enseignants. On peut espérer que cela développera du même coup leurs compétences professionnelles, mais il revient à l’intéressé d’inscrire ces apports dans une perspective pédagogique et didactique.
Une compétence est un savoir-mobiliser. Ce n’est pas une technique ou un savoir de plus, c’est une capacité de mobiliser un ensemble de ressources - savoirs, savoir-faire, schèmes d’évaluation et d’action, outils, attitudes - pour faire face efficacement à des situations complexes et inédites. Il ne suffit donc pas d’enrichir la palette des ressources pour que les compétences se trouvent immédiatement accrues, car leur développement passe par l’intégration, la mise en synergie de ces ressources en situation, et cela s’apprend. Maîtriser le traitement de texte, quelques didacticiels et un peu d’informatique est une condition nécessaire pour intégrer l’ordinateur à une pratique de classe, mais si la formation continue ne travaille pas sur cette intégration, qui est l’objectif-obstacle majeur, la ressource restera virtuelle et, faute d’être mobilisée, deviendra inutile. De même pour l’évaluation formative, la typologie de textes ou le conseil de classe !
Il ne va donc pas de soi que toute formation continue participe directement et intensivement à la construction de compétences. Nombre de perfectionnements n’offrent que des ingrédients et abordent marginalement les pratiques, ce qu’on peut d’ailleurs comprendre : alors qu’il est relativement facile d’apporter du neuf - idées, technologies, outils -, il est beaucoup plus difficile d’intégrer ces apports à une gestion de classe et à un système didactique.
À moins de laisser cette intégration aux soins de chacun, elle passe, en formation continue, par l’analyse de pratiques et de situations de classe, ce qui suppose que les enseignants jouent le jeu, que les formateurs soient à la hauteur et que les conditions de travail (cadre, temps, confiance) s’y prêtent. La formation initiale a les moyens d’être " intrusive " : l’étudiant peut être observé en classe, amené à travailler avec la vidéo, ou en collaboration avec un maître de stage (ou un formateur de terrain), et mobilisé longuement par des tâches d’analyse ou d’écriture. En formation continue, les formateurs " marchent sur des œufs ". Ils forment leurs égaux. Ils n’entrent pas facilement dans les classes. Ils hésitent presque autant à s’engager dans une analyse des pratiques. Aux formateurs qui les accueillent en formation continue, le corps enseignant en place semble dire assez souvent : " Donnez-nous des outils et ne vous mêlez pas de ce qui se passe dans notre classe ! ", laissant entendre que c’est leur affaire.
Pour dire les choses de façon schématique : le développement de compétences, s’il advient, se produit souvent en aval de la formation continue, dans le for intérieur des enseignants, éventuellement d’une équipe pédagogique. Orienter la formation continue vers des compétences, c’est donc élargir le champ de travail et donner aux pratiques réelles davantage de place qu’aux modèles prescriptifs et aux outils. Une partie des offres de formation continue vont bien sûr déjà dans ce sens, mais cela ne me semble pas encore la conception commune, ni la règle du jeu ou si l’on préfère, le contrat didactique de base, en formation continue.
La formation en établissement est un important pas en avant dans ce sens, non seulement parce qu’elle constitue un collectif de formation, mais parce qu’elle se passe sur le lieu de travail et se trouve moins facilement coupée des pratiques. Cela n’est toutefois qu’un avantage virtuel : on peut imaginer des formations en établissement qui se passent dans une salle close et à heures fixes, le formateur ayant aussi peu accès aux classes que s’il recevait les enseignants dans un centre éloigné…
Formation et politique de l’éducation
Le second enjeu est de dire quelles compétences la formation continue veut développer en priorité. À Genève, trois orientations constituent autant de balises :
L’ensemble de ces orientations ont été négociées entre l’association professionnelle et la direction de l’enseignement primaire, et avec l’Université pour la formation initiale, au sein de la Commission de la formation et d’autres instances (groupe-projet sur la formation initiale, groupe de pilotage de la rénovation et commissions diverses), tout cela dans le cadre de la politique d’ensemble de l’école genevoise. Il importe d’y insister, car le mode d’élaboration de ces dispositifs de formation ou d’innovation est aussi important que leur contenu. Ils sont en effet élaborés en commun, les inévitables divergences sont mises sur la table, travaillées et l’on aboutit à des dispositifs auxquels adhèrent l’ensemble des partenaires concertés, stabilisés dans des contrats, des cahiers des charges ou d’autres textes de référence.
L’approche par compétences présentée ici n’est qu’une composante des travaux de la Commission de la formation, qui poursuit actuellement sa réflexion, d’une part sur les structures et les services qui sous-tendent les offres de formation continue, d’autre part sur les relations entre compétences et contrôle de la qualité de l’enseignement.
Il apparaît cependant possible de faire état des orientations thématiques qui se dessinent. Il s’agit globalement de lutte contre l’échec scolaire et les inégalités, de renouvellement didactique et d’insistance sur le sens du travail scolaire, mais aussi, indissociablement, de développement de la coopération professionnelle dans le cadre de projets d’école et de contrats entre établissements et direction. D’autre part, tout cela explique l’accent mis sur dix grands domaines de compétences :
- Organiser et animer des situations d’apprentissage.
- Gérer la progression des apprentissages.
- Concevoir et faire évoluer des dispositifs de différenciation.
- Impliquer les élèves dans leur apprentissage et leur travail.
- Travailler en équipe.
- Participer à la gestion de l’école.
- Informer et impliquer les parents.
- Se servir des technologies nouvelles.
- Affronter les devoirs et les dilemmes éthiques de la profession.
- Gérer sa propre formation continue.
On parle de domaines de compétences parce que chacun recouvre plusieurs compétences complémentaires. À chaque entrée de cette liste ont donc été associés quelques exemples de compétences-clés. Ce référentiel à deux étages (voir le tableau en annexe) est devenu à la rentrée 1996-97 une référence commune, qui figure dans le classeur intitulé " Formation continue. Programme des cours 1996-1997 " (Genève, Enseignement primaire, Service du perfectionnement, 1996).
En amont, les services et les formateurs ont été invités à infléchir leurs offres dans le sens d’une ou plusieurs des compétences. Toutes les offres qui ont pu tenir compte du référentiel sont donc situées graphiquement par rapport aux dix grandes familles. Par exemple, le cours 101 " Géographie : espace vécu et représentation " (une journée) est situé comme suit :
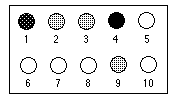
Le disque coloré en noir indique la famille de compétences travaillée en priorité (4. Impliquer les élèves dans leur apprentissage et leur travail). Le disque coloré en gris foncé indique une priorité moyenne (1. Organiser et animer des situations d’apprentissage), les disques colorés en gris clair une priorité faible (2. Gérer la progression des apprentissages, 3. Concevoir et faire évoluer des dispositifs de différenciation et 9. Affronter les devoirs et les dilemmes éthiques de la profession.). Les disques non colorés correspondent aux familles de compétences non concernées. Chaque cours définit ainsi son profil de compétences.
Un tableau global à double entrée met en relation les thématiques des cours (en ligne) et les familles de compétences (en colonne), si bien qu’on peut entrer par les unes ou par les autres dans la recherche d’une formation continue.
Une partie des offres de formation ont été codifiées de cette façon sans avoir pu être conçues et développées à partir du référentiel, puisqu’il n’a été stabilisé qu’à la fin de l’année scolaire 1995-96. Il serait aventureux de prétendre que le référentiel a été lu, compris et accepté de la même manière par tous. Pour les uns, il recoupe des catégories familières, alors que d’autres sont plus à l’aise dans une logique de contenus, les compétences restant " en creux ". Dans le champ des didactiques, les offres sont en général plus ciblées sur des disciplines et des types d’activités à proposer aux élèves que sur des compétences des enseignants. On peut donc estimer que, comme tout référentiel, l’outil peut ;
La balle est dans le camp des formateurs, des services, de la direction, aussi bien que des enseignants : ces domaines de compétences demandent à être habités, ils ne sont encore que des cadres vides, dans lesquels il importerait que les acteurs investissent des représentations plus précises, au prix d’un travail et de débats.
Bien entendu, chaque mot, chaque idée peut susciter une controverse acharnée sur la pédagogie, les théories de l’apprentissage, les finalités de l’école ou le métier d’enseignant. Ce débat importe plus qu’un consensus sur le détail, qui serait plutôt inquiétant ! À travers la discussion sur les contenus se profile une façon nouvelle de penser la formation, au total plus féconde que la signification exacte qu’on donne à chaque formulation. Une idée telle que " Concevoir et faire évoluer des dispositifs de différenciation " ne peut qu’amener une interrogation ouverte sur les pédagogies différenciées. L’approche par compétences est un enjeu plus important que le référentiel, qui n’est qu’un langage commun, destiné à mettre un peu d’ordre dans la complexité.
Du côté des enseignants
Si le référentiel est, dans un premier temps, une façon de structurer les offres, il reste qu’à moyen terme, la formation continue est fortement infléchie par ses utilisateurs. Si les enseignants ne s’approprient pas le référentiel pour penser leurs propres compétences, donc leurs besoins de formation, il restera lettre morte. On se heurte ici à un premier écueil : la notion de compétence relève du sens commun, mais cette familiarité est à la fois un avantage et un handicap. Un avantage parce que nul ne niera qu’il faille des compétences pour enseigner efficacement, un handicap parce que, lorsqu’on enfonce une porte ouverte, il semble superflu de commenter explicitement " ce que tout le monde sait et sait faire ". Comme beaucoup d’innovations, cette conception affinée de la formation continue doit naviguer entre plusieurs écueils :
Ces réactions sont parfaitement compréhensibles, compte tenu du niveau d’abstraction de tout référentiel. Admettons qu’on propose à des médecins cherchant une formation continue un domaine de compétences énoncé comme suit " Poser et vérifier un diagnostic ". Il leur serait facile d’ironiser sur cette formulation, de dire " Et moi qui croyait que cela faisait partie de la formation initiale de base ! " ou " Quel scoop, les médecins doivent poser un diagnostic ! Première nouvelle ! " Pourtant, souvenez-vous : quand vous êtes vraiment malade et que les symptômes ne sont pas immédiatement lisibles, une angoisse vous saisit : et si mon médecin n’arrivait pas à comprendre ce que j’ai et à me soigner à temps ? Poser un diagnostic est une compétence de base de la profession médicale, elle est donc toujours " déjà là ". Et pourtant, elle n’est jamais achevée et doit se renouveler constamment, en fonction des avancées de la recherche, des technologies, mais aussi des pathologies.
Tous les enseignants sont appelés à " Organiser et animer des situations d’apprentissage ". S’ils n’ont aucune compétence dans ce domaine, on peut se demander pourquoi ils ont choisi ce métier et comment ils ont obtenu le droit d’enseigner. Et pourtant, qui pourrait se vanter d’avoir acquis une totale maîtrise dans ce domaine ? Et surtout, qui pourrait ignorer que la conception même de l’enseignement, des situations d’apprentissage, du rôle du maître, ont profondément évolué depuis une vingtaine d’années, sous l’impulsion de la recherche en didactique des disciplines et de l’expérience des écoles actives, de l’éducation nouvelle, du mouvement Freinet, des pédagogies du projet, etc. Aujourd’hui, il apparaît clair qu’enseigner ne consiste plus à donner de bonnes leçons, mais à faire apprendre, en plaçant les élèves dans des situations qui les mobilisent, les stimulent dans leur zone proximale de développement, leur permettent de donner du sens au travail et au savoir. Qui pourrait prétendre, aujourd’hui, maîtriser conceptuellement et plus encore pratiquement l’art d’organiser et animer des situations d’apprentissage ? Compétence élémentaire à son plus bas niveau, inaccessible étoile à son niveau le plus achevé, cette compétence est un chantier qui n’est pas près d’être fermé.
Pour s’en rendre compte, l’important serait non de juger le référentiel comme tel, mais d’y entrer et de confronter les représentations des uns et des autres, de faire le bilan des acquis, d’identifier les problèmes ouverts et les prochaines étapes. Cela représente un travail en lui-même formateur. Il faut donc souhaiter que le débat s’engage, que ce référentiel soit progressivement habité et donc développé, nuancé, voire notablement remanié au fil des années. Ce travail peut prendre place dans divers cadres. Il importerait qu’il ait lieu dans les sessions et cours de formation eux-mêmes, qu’on considère l’identification des compétences visées comme partie intégrante de la formation, sans limiter l’usage du référentiel à la description des cours. Ainsi, dans l’exemple pris plus haut, il serait formateur d’expliciter en quoi le contenu et la démarche proposés touchent aux compétences mentionnées.
Du côté des inspecteurs
Le référentiel s’impose aux formateurs et il propose aux enseignants une clé de lecture des offres. En quoi les inspecteurs sont-ils concernés ?
Ils peuvent et sont évidemment invités à se servir du référentiel comme d’un langage qui progressivement deviendra commun dans le dialogue avec les enseignants et les équipes. Le groupe qui accompagne les écoles en innovation dans le cadre de la rénovation genevoise de l’enseignement primaire (groupe de recherche et d’innovation, GRI) peut évidemment faire de même.
Sans doute les inspecteurs peuvent-ils inciter les enseignants à dresser leur propre bilan de compétences et à faire des choix de formation continue dans cette perspective.
Peut-on aller encore plus loin ? On entre là dans une zone à hauts risques, qui est celle du contrôle, donc de la fonction de l’inspection aujourd’hui. Entre une impossible obligation de résultats - faire réussir chacun, dans n’importe quelle condition - et une stérile obligation de moyens - utiliser toutes les fiches du classeur de mathématique -, les systèmes éducatifs sont à la recherche d’un " contrôle intelligent " des pratiques enseignantes.
Contrôle intelligent, qu’est-ce à dire ? Le terrain est miné parce qu’on se trouve très vite dans le débat sur l’évaluation des enseignants et le salaire au mérite. Je tenterai dans un prochain article de construire une problématique plus large, en abordant trois questions complémentaires :
On s’en doute, le problème est trop complexe pour être résolu sur le papier. Mais peut-être l’approche par compétences donne-t-elle une chance de concilier la logique de la professionnalisation, qui insiste sur la responsabilité et l’autonomie, et la logique du service public.
S’il est vrai que tous les systèmes éducatifs sont à la recherche d’un " contrôle intelligent " des pratiques enseignantes, avant de se demander : " De qui est-ce l’affaire ? ", peut-être faut-il s’arrêter à une question préalable : sur quoi l’évaluation et le contrôle peuvent-ils porter ?
Nul n’est " à son compte " dans une organisation scolaire. Chacun doit donc des comptes : on le rémunère pour un travail, qui comprend des obligations. Lorsque vous payez un plombier pour réparer votre tuyauterie, son obligation est de le faire correctement, à un coût et en un temps raisonnables, fixés parfois par un devis. S’il n’y parvient pas, il doit démontrer que l’installation est irréparable ou que l’entreprise dépasse la simple plomberie. En principe, un enseignant est astreint, en contrepartie de son salaire, à une obligation analogue : éduquer et instruire les élèves qui lui sont confiés, conformément au programme et à son cahier des charges. Il apparaît cependant difficile d’évaluer l’éducation et l’instruction d’êtres humains comme on évalue le rendement d’une action matérielle. Ne serait-ce que parce que les élèves, les classes et les établissements sont différents et qu’on ne saurait imposer une obligation de résultats au mépris de ces différences.
Meirieu (1989) en a conclu qu’il faut renoncer à une " obligation de résultats ", définis en termes d’apprentissages calibrés, les mêmes pour tous. Il ne propose pas pour autant de délivrer les enseignants de toute obligation ! Il propose de substituer à l’obligation de résultats une " obligation de moyens ". J’irai ici dans le même sens, en tentant toutefois de dépasser l’ambiguïté de l’expression " obligation de moyens ". On peut en effet l’entendre en deux sens diamétralement opposés, que je vais distinguer en utilisant deux expressions nouvelles " obligation de procédure " (ou de méthode) et " obligation de compétence ".
J’appellerai :
Je vais tenter dans cet article :
Une impossible obligation de résultats
Il y a des domaines du travail humain dans lesquels il est possible et légitime d’exiger des résultats. Il faut pour cela réunir aux moins quatre conditions :
Ces conditions ne sont pas réunies pour l’enseignement. Voyons pourquoi.
Une action non technique
Aucune action humaine n’est-elle entièrement technique, chaque agent d’une organisation conserve une marge d’interprétation des objectifs qu’on lui assigne. D’un métier à l’autre, cependant, l’étendue de cette marge diffère. L’action éducative ne s’inscrit jamais complètement à l’intérieur de finalités parfaitement claires et assignées de l’extérieur et n’est donc pas réductible à la question du choix des moyens les plus efficaces d’atteindre des objectifs univoques. L’enseignement, avec d’autres métiers de l’humain, est donc toujours, à la fois, définition des fins et recherche des moyens.
D’abord parce que les objectifs de l’éducation scolaire sont trop nombreux et ambitieux pour qu’on puisse les poursuivre tous. Il est possible, sur le papier, de ne renoncer à rien et de charger les programmes en ajoutant, de-ci, de-là, une petite phrase, dont la transposition didactique exige des heures de travail avec les élèves. On ne peut, dans l’espace et le temps réels de la classe, courir tous les lièvres. Chaque enseignant est donc amené, qu’il le veuille ou non, à faire ce que les auteurs des programmes n’ont pas su ou voulu faire. Consciemment ou non, il adopte certaines priorités, compte tenu des élèves qu’il a réellement en face de lui, des attentes et des attitudes de leurs parents, de ses convictions et compétences personnelles, ou encore des conceptions pédagogiques qui prévalent parmi ses collègues.
Même si les objectifs de l’éducation scolaire étaient tous réalisables dans le temps imparti, ils prêteraient à interprétation. Les objectifs cognitifs en apparence les plus limpides, tels que maîtriser la soustraction ou l’usage du conditionnel, ouvrent en fait la porte à diverses interprétations. On n’enseignera pas ces savoirs et savoir-faire de la même manière selon qu’on vise des performances de surface ou une véritable compréhension, selon qu’on intègre ces connaissances à des structures plus complexes - les opérations mathématiques ou les actes de parole - ou qu’on les traite pour elles-mêmes, selon, enfin, qu’on les considère comme des composantes de compétences plus larges - résolution de problèmes ou capacité de communication - ou qu’on les traite pour elles-mêmes. À ces dimensions cognitives, fonction d’une théorie plus ou moins constructiviste de l’apprentissage ou de l’action, s’ajouteront toutes les différences liées à la culture et aux valeurs personnelles de l’enseignant. Comment quelqu’un qui adore les voyages et parcourt la planète pourrait-il enseigner la même géographie que quelqu’un qui passe chaque année ses vacances dans le même chalet ? Comment quelqu’un qui aime écrire et compose couramment des textes, dans le cadre de sa vie personnelle ou militante, pourrait-il enseigner la rédaction de textes de la même façon qu’un enseignant n’ayant ni le goût, ni la pratique de l’écriture ?
Bref, on ne peut prêter à chaque enseignant exactement les mêmes intentions éducatives, ni, lorsqu’elles sont semblables, la même énergie et la même détermination pour les réaliser. Ces variations d’objectifs sont à la fois inévitables et souhaitables, lorsque des êtres humains travaillent avec d’autres êtres humains…
Une action dépendante d’autrui
Tous les professionnels se heurtent à des résistances. Si tout était facile, on n’aurait pas besoin de recourir à des gens qualifiés. Mais il y a résistances et résistances… Celles qu’opposent à l’action humaine la nature et les matériaux entraînent en général des dépassements de temps et de crédits, sans compromettre l’entreprise elle-même. Autrement dit, on vient à bout de la tâche, c’est une question de patience et de moyens. Des résistances des êtres humains, on ne peut faire façon aussi simplement, sauf à pratiquer la violence. Et encore : même les dictatures qui recourent à la répression et à la torture ne viennent à bout des résistances que provisoirement, et à quel prix !
Une action éducative respectueuse des personnes et qui vise à développer leur autonomie se refuse à utiliser la violence physique. Même lorsque l’école avait moins de scrupules et n’hésitait pas à manier la férule (" Petite palette de bois ou de cuir avec laquelle on frappait la main des écoliers en faute ") ou le fouet et à se permettre d’autres atteintes à l’intégrité corporelle des élèves, les enseignants ne contrôlaient de la sorte que les conduites, au mieux des apprentissages très superficiels.
Il subsiste aujourd’hui une " violence symbolique " (Bourdieu et Passeron, 1970), autrement dit une pression morale (" C’est pour ton bien ! ", Miller, 1968), un chantage affectif, voire des menaces de sanctions qui font que l’instruction n’est pas un libre choix, en particulier lorsqu’elle est légalement obligatoire ou imposée par l’autorité parentale. Toutefois, au fil des générations, la légitimité des moyens de pression symbolique s’affaiblit et les capacités de résistance des élèves s’accroissent. C’est un paradoxe, car aucune société n’a adhéré aussi fortement, toutes classes sociales confondues, au principe du salut par l’instruction. Mais justement, cela donne des droits et engendre des espoirs qui, lorsqu’ils sont déçus, provoquent des réactions amères ou agressives. Moins que jamais, dans les pays démocratiques et développés du moins, le métier d’enseignant n’a été confronté a autant de résistances individuelles ou collectives des enfants et des adolescents, alors que l’école s’est graduellement privée de moyens de répression autrefois courants, qu’on estime aujourd’hui barbares.
L’efficacité pédagogique est donc fonction de la coopération des élèves et de leurs familles. Certes, la compétence professionnelle consiste en partie à créer, entretenir et développer cette coopération, mais cela ne fait que déplacer le problème : pour donner envie d’apprendre, de travailler ou simplement de venir à l’école, il faut agir sur des valeurs et des attitudes, ce qui n’est pas plus simple que d’instruire, apparaît moins légitime et rencontre d’autres résistances.
On ne saurait donc tenir l’enseignant pour comptable des résultats de son action sans tenir compte de l’attitude et des conduites de ses partenaires, qui se comportent parfois comme ses " adversaires " dans la relation éducative. Or, la coopération et la résistance qu’on rencontre dans une classe dépendent d’un nombre important de facteurs, les uns prévisibles en fonction du niveau, de l’origine sociale ou du passé scolaire des élèves, ou de l’environnement social et culturel de l’établissement, les autres imputables à une dynamique de groupe et à une relation pédagogique qui constituent des histoires singulières, dont l’enseignant est un acteur, non le " deus ex machina ".
C’est d’autant plus vrai qu’il doit résister à la tentation de toute-puissance, se souvenir que la pédagogie commence par la reconnaissance de la résistance de l’autre comme signe de son identité de sujet (Cifali, 1994 ; Meirieu, 1995). Briser cette résistance par n’importe quel moyen, ce serait nier l’autre comme sujet et donc miner le sens même de l’entreprise éducative. Chaque éducateur porte en lui la tentation de Frankenstein (Meirieu, 1996) et, pour la combattre, doit souvent choisir d’être moins efficace pour être plus respectueux des personnes et de son métier. Ce dilemme éthique suffirait, à lui seul, à condamner le principe d’une obligation de résultats.
Une action incertaine
Pour exiger des résultats, il faudrait pouvoir démontrer que, placé devant le même problème, tout professionnel qualifié aurait trouvé une solution efficace sans pour autant faire preuve de génie, ni même d’une grande créativité, simplement en mobilisant l’état de l’art et des savoirs professionnels et savants reconnus. Pour une partie des situations professionnelles qu’ils affrontent, le médecin ou l’ingénieur se trouvent dans ce cas de figure : on ne leur demande pas d’inventer des savoirs nouveaux, de créer des méthodes, mais de mettre en œuvre un capital collectif. Tous se passe alors comme si ce capital garantissait une action efficace, la seule responsabilité du professionnel étant de le connaître et de l’investir avec discernement.
En éducation, les situations de ce genre n’abondent pas. On a, au contraire, une profusion de situations face auxquelles la plupart des professionnels seraient tout aussi démunis ou hésitants. Bref, l’échec de l’action éducative renvoie souvent à une incompétence collective plus qu’à une incompétence individuelle. Les savoirs professionnels et les savoirs savants ne sont pas assez avancés et stabilisés pour qu’on puisse attendre d’un professionnel qu’il soit efficace du seul fait qu’il est bien formé et informé. La pédagogie est, à nombre d’égards, dans la situation où se trouvaient l’ingénierie ou la médecine il y a deux ou trois siècles : certaines prouesses technologiques ou thérapeutiques devenues courantes relevaient alors de la science-fiction, car les savoirs de l’époque ne donnaient aucune prise sur un grand nombre de phénomènes.
Pour une part de son travail, l’enseignant se trouve dans la situation d’un médecin auquel on demanderait de guérir une maladie infectieuse dont les mécanismes de base seraient encore inconnus, voire insoupçonnés, ou d’un ingénieur dont on attendrait une réalisation dépassant les théories et les technologies maîtrisées à son époque.
Comment, en bref, pourrait-on exiger des résultats de niveau défini quand aucun autre professionnel, aussi qualifié soit-il, ne pourrait mieux les garantir ?
Une action singulière
À l’idée d’évaluer les résultats obtenus par les enseignants en termes d’acquis de leurs élèves, on oppose volontiers un argument classique : il serait impossible de comparer des classes en raison de la diversité des contextes, du nombre et du niveau des élèves à l’entrée, de la composition sociale et ethnique du public, du nombre et de la nature des cas particuliers.
Cette singularité est parfois un alibi. Il me semble qu’on se heurte sur ce point à plusieurs difficultés distinctes :
Des comparaisons hermétiques : les techniques statistiques relevant de " l’analyse de la variance " permettent de contrôler un ensemble d’autres déterminants de la réussite scolaire et donc d’isoler " l’effet-maître ". Il est simplement peu probable que des comparaisons fondées sur des méthodes aussi sophistiquées, dont le commun des mortels ne saisit pas les bases mathématiques, puissent être utilisées hors du contexte de la recherche. On pourrait cependant imaginer des méthodes plus intuitives, fondées par exemple sur une pondération de divers facteurs. La moindre chaîne de distribution commerciale sait qu’elle ne peut attendre de chacune de ses succursales le même chiffre d’affaire, que celui-ci variera en fonction du quartier, de la concurrence, de l’implantation plus ou moins récente et plus ou moins heureuse du magasin, de son environnement et autres variables sur lesquelles le gérant n’a guère de prise. Cela n’empêche pas une évaluation, en fonction de comparaisons raisonnables. Les enseignants ne pourront prétendre indéfiniment que leur situation n’est comparable à aucune autre : toutes les classes ne sont pas comparables, mais on peut former des sous-ensembles plus homogènes à l’intérieur desquels les comparaisons ont un certain sens.
Des facteurs non analysés : au-delà des paramètres les plus triviaux et les plus contrôlables, l’efficacité de l’action éducative dépend de facteurs plus subtils, moins mesurables, parfois non encore conceptualisés. Certains d’entre eux, de plus, loin d’être donnés au départ, se construisent dans l’interaction pédagogique et didactique, au fil du temps scolaire. Entre un enseignant et ses élèves, chaque année, se noue une histoire humaine originale, qu’il est bien difficile de transformer en " variables " observables
Des comparaisons sans fondement : il serait injuste de rendre l’enseignant responsable de certains caractéristiques qui, autant que ses compétences, influencent son action éducative : son appartenance à une ethnie, une classe sociale, un sexe, un âge de la vie, une communauté confessionnelle, ou encore son histoire, sa culture, son physique, son odeur, sa façon de parler ou de bouger, ses goûts vestimentaires, tout cela exerce une influence sur la communication et la relation pédagogiques. Ces éléments ne relèvent pas de la compétence professionnelle, mais de l’identité personnelle et culturelle, de la manière d’être au monde. De plus, ces caractéristiques n’ont pas d’effets univoques : elles dépendent de leur interaction avec les caractéristiques correspondantes, les attentes et les normes des élèves et des familles. La même enseignante, le même enseignant provoqueront des attractions ou des rejets individuels ou collectifs selon qui se trouve en face d’eux. Mais surtout, ce jugement évoluera au gré de l’histoire commune : un défaut de prononciation ou un excès de poids peuvent être attendrissant ou irritant, selon les enjeux et les stratégies des uns et des autres.
Le refus de la boîte noire
En conclusion : l’obligation de résultats n’a de sens que dans la perspective extrêmement simplificatrice selon laquelle une classe serait une boîte noire dont on identifie les " inputs " et les " outputs " : on contrôlerait tous les inputs qui ne relèvent pas de la qualification et de la conscience professionnelles de l’enseignant, et il resterait une relation pure entre ces derniers facteurs et les résultats des élèves. Si les théories et les méthodes permettent un jour une telle décomposition, ce sera dans des décennies et la position des problèmes aura changé. Pour l’heure, c’est au mieux une problématique de recherche.
Une stérile obligation de procédure
Qu’est-ce qui sépare un métier d’exécutant d’une profession qualifiée ? Dans le premier, la part du travail prescrit est prépondérante, ce qui conduit à exiger du salarié, avant tout, la conformité aux procédures décidées par les ingénieurs ou autres responsables de l’organisation du travail. Si, respectant les procédures à la lettre, on parvient à de mauvais résultats, la responsabilité incombe à ceux qui ont défini les procédures. Le salarié peut dire " Je n’y suis pour rien, je n’ai fait qu’appliquer la règle ".
Plus on va vers des professions qualifiées, plus l’organisation limite le travail prescrit et, bon gré mal gré, délègue aux salariés le souci de créer ou d’adapter des procédures pour faire face à la complexité des situations.
En tirant l’enseignement vers l’obligation de procédure, on freine donc le processus de professionnalisation. Ce serait justifié si on garantissait de la sorte une véritable efficacité de l’enseignement. Il n’en est rien. Une stricte obligation de procédure est à la fois un obstacle à la professionnalisation et un déni de la complexité. Elle conforte, de plus, une vision dépassée de l’enseignement-apprentissage. Voyons pourquoi.
Un obstacle à la professionnalisation
La professionnalisation d’un métier, quel qu’il soit, se définit précisément par l’autonomie qui permet au vrai professionnel de choisir ses méthodes et moyens d’action, en assumant pleinement la responsabilité de ses décisions. Plus le système éducatif restreint l’autonomie des enseignants quant au choix de leurs méthodes et moyens d’enseignement et d’évaluation, plus il limite leur responsabilité, accentuant ce qu’on peut appeler une prolétarisation ou une déprofessionnalisation de leur métier, bref une dépendance accrue à l’égard de règles conçue par la hiérarchies ou des spécialistes (Perrenoud, 1994 a, 1996 e).
L’obligation de procédure dénie à l’enseignant la capacité de choisir ou de construire lui-même ses stratégies et ses méthodes. Elle laisse planer, sans l’exprimer clairement, un soupçon sinon d’incompétence, du moins de manque de discernement dans le choix autonome d’une méthode. Ce manque de confiance devrait s’affaiblir au gré de l’accroissement progressif du niveau de formation des enseignants. Or, paradoxalement, il semble s’aggraver, en raison notamment de l’émergence de didactiques pointues défendues par des spécialistes aux yeux desquels une partie des enseignants font " n’importe quoi " si on les laisse à eux-mêmes.
La résistance à la professionnalisation peut s’enraciner aussi, du côté des autorités, dans la peur de la diversification des pratiques ou de l’autonomie des écoles, inéluctable lorsque les praticiens coopèrent pour mettre en place des dispositifs nouveaux. L’obligation de procédure peut donc, à la fois, maintenir l’autorité des responsables et accroître l’influence des spécialistes…
Un déni de la complexité
La professionnalisation n’est pas à mes yeux une fin en soi, mais une réponse à la complexité des situations et des relations éducatives et aux attentes croissantes des sociétés à l’égard du système éducatif. Pour des raisons multiples (changement des rapports à l’école et aux savoirs, brassages culturels, transformation de la famille, crise des valeurs, rapide obsolescence des savoirs, concurrence des hypermédias, crise économique, désorganisation urbaine, rupture du contrat social, etc.), il n’est plus possible d’enseigner de façon stéréotypée. Une fraction croissante des situations d’enseignement-apprentissage exige au contraire, du moins si l’on veut lutter contre l’échec et permettre au plus grand nombre de progresser, des stratégies originales et sur mesure, partant de l’analyse des acquis, des besoins, des ressources et des forces hic et nunc.
Faire face à la complexité, c’est être un praticien réfléchi (St-Arnaud, 1992 ; Schön, 1994, 1996), disposant de connaissances multiples, d’outils méthodologiques, d’une capacité de coopération avec des collègues et surtout d’un savoir-analyser bien rodé pour guider observations, interprétations et régulations. Le strict respect de procédures prescrites est, dans nombre de situations complexes, un gage d’inefficacité. Cela ne signifie pas qu’aucune procédure ne peut être pensée, puis proposée aux praticiens ; ils n’ont ni le temps ni la force de réinventer la roue tous les jours. En dernière instance, cependant, il appartient à des professionnels et autonomes d’évaluer la pertinence des procédures disponibles dans chaque contexte et, le cas échéant, de les adapter à la situation, de s’en écarter sur tel ou tel point, voire d’en créer de nouvelles. Pour agir efficacement, il faut à la fois pouvoir puiser dans des méthodes, des règles, des procédures préétablies lorsqu’elles sont pertinentes et s’en libérer lorsque la situation l’exige.
Une vision dépassée de l’enseignement-apprentissage
L’obligation de procédure est un frein à l’émergence de nouvelles représentations de l’enseignement et de l’apprentissage. Depuis plus d’un siècle, les militants de l’école nouvelle et des méthodes actives affirment qu’on apprend en faisant. Constructivistes et interactionnistes avant la lettre, ils sont aujourd’hui confirmés dans leurs vues par de multiples travaux de sciences de l’éducation. On assiste à un total renversement de perspective. Enseigner consiste désormais à faire apprendre, autrement dit à construire et animer des situations d’apprentissage (Astolfi, 1992 ; Develay, 1992). On place l’enfant " au centre du système éducatif ", ce qui veut dire que, loin de l’intégrer à un cours des choses pensé en dehors de lui, on cherche à différencier l’enseignement en fonction des possibilités et des façons d’apprendre de chacun.
Un enseignant, à supposer qu’il connaisse sa discipline et que les élèves soient " bien tenus ", peut construire et dispenser un cours en suivant des procédures. Il ne peut en revanche développer des séquences et des situations d’apprentissage que dans une démarche de résolution de problèmes et de conduite de projets, en créant des situations-problèmes (Meirieu, 1989), en impliquant les élèves dans leur apprentissage. Pour ce faire, il peut certes s’inspirer de précédents et de modèles, il peut s’approprier des démarches construites par d’autres et partiellement codifiées, pour être communicables, mais il ne peut espérer parvenir à des résultats en suivant constamment une méthodologie toute faite.
Le souci de différenciation de l’enseignement va dans le même sens. Si différencier, c’est organiser les interactions et les activités de sorte que chaque élève soit aussi souvent que possible confronté aux situations didactiques les plus fécondes pour lui (Perrenoud, 1995), on voit bien que l’enseignant ne peut suivre aucun rail et doit plutôt se demander sans cesse ce qui se passe et ce qu’il peut proposer de pertinent à chacun, dans une démarche d’identification et de résolution de problèmes.
Vers une obligation de compétences ?
Quelle différence y a-t-il entre une obligation de procédure et une obligation de compétence ? La réponse figure déjà en creux dans l’analyse qui précède. Pour dire les choses autrement, arrêtons-nous un instant à la notion de faute professionnelle. Une obligation se définit en effet par la nature des manquements qu’elle rend possibles.
De l’écart à la règle au défaut de jugement
Qu’est-ce qu’une faute professionnelle ? C’est une décision malheureuse, autrement dit porteuse de graves conséquences. Ce n’est pas un accident, une fatalité, mais la résultante d’une erreur humaine Toutefois, cette erreur peut prendre des formes très différentes selon le degré de prescription du travail.
Dans les métiers d’exécution, assujetti à une obligation de procédure, l’erreur consiste à ignorer ou transgresser la procédure. Elle est commise par celui qui, par manque de sérieux, de concentration, d’attention ou par désinvolture, a cru pouvoir ne pas respecter les normes et les méthodes prescrites : règles de sécurité, code de déontologie, disposition essentielle du cahier des charges et procédures dictées par l’organisation du travail.
Aucune profession autonome et responsable n’est totalement exempte de procédures. Les obligations de procédure se situent alors plutôt en amont des situations. Elles enjoignent au professionnel, par exemple, de ne pas affronter une situation difficile sans être en bonne condition physique ou mentale, sans disposer de ses outils ou assistants habituels ou sans savoir tout ce qu’il devrait savoir. C’est ainsi qu’un chirurgien commet une faute s’il opère sans être capable de résister au stress et de tenir le coup, un anesthésiste s’il ne connaît pas les antécédents du patient, un pilote s’il décolle sans copilote, etc. Ces erreurs élémentaires sont les plus faciles à identifier. Les autres, celles qui ne portent pas sur les conditions de la décision, mais sur son bien-fondé, sont beaucoup plus difficiles à définir et à établir. Parce que la qualification consiste justement à agir en l’absence de norme explicite qu’il suffirait de suivre pour être irréprochable. Ce qu’on attend d’un professionnel, et c’est pourquoi on le forme et on le rétribue, c’est de trouver une stratégie d’action efficace même et surtout lorsqu’il n’existe aucune procédure prédéfinie à la mesure de la situation. La faute professionnelle peut alors se définir comme à une réaction indéfendable, dans la situation de travail considérée, de la part d’un expert consciencieux et qualifié. Une décision malheureuse traduit alors un manque de capacité à analyser la situation et à choisir la réponse appropriée.
Ici encore, c’est une question de dosage. Aucun métier ne dispense d’une part de jugement et donc d’un risque d’erreur. Cela peut arriver au chauffeur routier qui sous-estime la courbure d’un virage, à l’esthéticienne qui brûle gravement sa cliente, à l’infirmière qui ne détecte pas l’aggravation subite de l’état d’un patient, au programmeur qui laisse une grossière erreur dans son programme, au laborantin qui sabote une culture biologique par mauvaise compréhension de l’expérience en cours, etc. Cependant, plus on va vers des métiers qualifiés, plus s’accroît la part des gestes professionnels relevant du jugement en situation. Les situations sont diverses, mouvantes, complexes pour qu’il soit possible de dicter, ni même de proposer des procédures. C’est bien pourquoi on délègue à un professionnel compétent le pouvoir et la responsabilité de savoir mieux que personne ce qu’il convient de faire, parce qu’il a tous les éléments en main, en temps réel. Son éventuelle faute professionnelle n’est pas alors de l’ordre d’une infraction à une règle, parce qu’il n’y a pas de règle, seulement des principes généraux, un état de l’art et une attente globale à l’égard du praticien : qu’il fasse preuve de discernement, de sang-froid, d’esprit d’initiative ou de décision.
Au-delà des fautes professionnelles
Les erreurs de jugement délimitent en creux le champ de la compétence et de l’obligation de compétence. Cette entrée paraîtra " peu positive ". Ce n’est qu’un analyseur. L’erreur est humaine et l’obligation de compétence n’est pas une obligation d’infaillibilité. Elle impose cependant, 9 fois sur 10, 99 fois sur 100 ou 999 fois sur 1000, selon les enjeux et les métiers, de réagir adéquatement, sur le vif, dans une certaine solitude, souvent dans l’urgence et l’incertitude (Perrenoud, 1996 e).
On conviendra sans doute que l’obligation de compétences est aussi fondamentale que difficile à contrôler. Faut-il attendre que se produise une faute professionnelle grave pour évaluer les compétences, au prix de procédures administratives ou pénales lourdes et peu formatrices ? On peut évidemment souhaiter qu’on parvienne à évaluer les compétences de façon plus banale et moins dramatique, en formation initiale et durant la carrière professionnelle. Faute de quoi on sera tenté de rêver d’une impossible obligation de résultats ou de revenir à une stérile obligation de procédure. Comment s’y prendre ? Et d’abord, de qui est-ce l’affaire ? Ce sera l’objet d’un prochain article.
Ayant défini l’obligation de compétences, il reste à passer d’une idée générale à sa mise en œuvre : une obligation que nul ne peut contrôler n’en est pas une. Si les compétences ne sont pas évaluables, ou seulement à la suite d’une faute professionnelle grave déclenchant une enquête, alors l’institution scolaire est condamnée soit à ne pas évaluer régulièrement le travail des enseignants, soit à choisir entre la peste et le choléra, autrement dit une impraticable obligation de résultats et une obligation de procédure qui fait obstacle à la professionnalisation de l’enseignement.
L’évaluation des compétences rencontre des difficultés conceptuelles et techniques. Pourtant, ce ne sont pas les obstacles principaux. Ils ne seront sérieusement étudiés et surmontés que lorsqu’on saura à qui il revient d’évaluer les compétences des enseignants. Or, à cette question épineuse, les systèmes éducatifs n’apportent pas de réponse bien claire. Ils oscillent de nos jours entre l’espoir un peu magique de voir le problème se résoudre par lui-même et l’hésitation des acteurs à s’engager dans un rôle perçu comme difficile, ingrat et à hauts risques.
Le rêve d’être débarrassé du problème
Deux espoirs vains hantent le débat sur l’évaluation des enseignants :
Sans être absurde, ces idées font preuve d’un bien grand optimisme quant au fonctionnement des organisations et des êtres humains. Voyons pourquoi, même s’il faut, pour cela, écorner quelques images d’Épinal.
Les limites de la certification initiale
Les systèmes éducatifs engagent, autant que possible, des enseignants au bénéfice d’une formation initiale certifiée. Ils peuvent donc espérer qu’ils auront les compétences requises du seul fait qu’ils ont franchi un double obstacle : 1. obtenir un diplôme ; 2. décrocher un emploi. Dans certains systèmes, cependant, ces deux barrières n’en font qu’une, car le diplôme garantit l’emploi. Même lorsqu’il existe un véritable marché du travail, les compétences ne constituent pas nécessairement le critère dominant de sélection.
Dans tous les cas, chaque système voudrait bien que la certification de la formation initiale soit un gage de compétence. Cet espoir, partiellement fondé, se heurte néanmoins à deux mécanismes assez généraux :
Passer entre les mailles du filet
Aucune procédure d’évaluation certificative n’est infaillible. La plupart des institutions de formation initiale combinent en général, pour décider d’une certification, des épreuves classiques de connaissances, de courtes visites d’un formateur ou d’un superviseur en classe et un rapport du " maître de stage ". Il serait bien audacieux de prétendre qu’on a, de la sorte, satisfait aux conditions techniques d’une évaluation rigoureuse et équitable des compétences. Toutefois, le principal obstacle à une certification " pure et dure " n’est pas d’ordre technique. Il tient à une réalité simple : le pouvoir d’évaluer est difficile à assumer dans la société actuelle, parce qu’il oblige l’évaluateur à dire, à certains évalués, des choses difficiles à entendre. Alors que le rapport pédagogique construit à l’école avec des enfants et des adolescents autorise les enseignants à porter des jugements très durs, parfois sans prendre de gants, l’évaluation se fait honteuse dans une partie du monde des adultes, notamment la fonction publique. Cela commence dès la formation initiale, qui se trouve souvent imbriquée au monde du travail, soit parce que c’est une formation en emploi, soit parce que les stages provoquent une immersion partielle dans les établissements.
À l’entrée ou au début d’un cursus de formation initiale, une éventuelle élimination repose sur des critères académiques classiques ou des attitudes. Comment pourrait-on évaluer des compétences alors que l’étudiant commence à peine à les construire ? Il semble urgent d’attendre. Toutefois, deux ans plus tard, alors que l’étudiant a progressé dans le cursus, l’évaluation ne paraît pas plus facile, parce que se joue désormais le sort d’une personne qui a investi une partie de sa vie dans une formation professionnelle, s’est forgé une identité de futur enseignant, s’est intégrée à des établissements, a occupé une place dans le dispositif au détriment d’autres candidats, a mobilisé des ressources qui seraient gaspillées si la formation n’allait pas à son terme. Pour interrompre cette trajectoire, il faut, outre de bonnes raisons, un vrai courage. Les formateurs le trouvent lorsqu’il y a contre-indication majeure : le système de certification en fin de parcours barre la route aux étudiants manifestement incapables d’enseigner. Encore faut-il qu’ils ne soient pas trop nombreux, car une trop forte proportion mettrait en cause le système de formation lui-même. Aux étudiants qui ne sont pas radicalement incompétents, on laisse volontiers le bénéfice du doute, on les garde aux études un ou deux semestres de plus, en feignant de croire que cela va les mettre à niveau et on les certifie, en faisant confiance à l’expérience et à la formation continue pour combler leurs lacunes…
Le rôle des maîtres de stage (appelés parfois formateurs de terrain) et des autres formateurs impliqués dans la certification finale est très inconfortable, ils sont pris dans un réel dilemme. Pour empêcher, voire pour retarder, l’accession d’une personne à un métier dont elle rêve, parfois, depuis son enfance, il faut avoir un autre souci, aussi fort : ne pas laisser entrer dans le métier une personne manifestement incompétente, qui ferait des dégâts. Or, s’il est relativement facile d’être catégorique sur des aspects personnels ou relationnels qui représentent des risques, on peut plus facilement minimiser des incompétences pédagogiques et didactiques " rachetées " par un amour indéfectible des enfants et un désir touchant d’enseigner. Si l’on participe à la mémoire collective d’un système éducatif, on sait bien qu’au gré des besoins et des fluctuations démographiques, on s’est montré parfois bien " arrangeant ", en confiant des classes à des gens faiblement ou rapidement formés. Pourquoi faire un malheureux en appliquant impitoyablement une norme qui, en d’autres temps, a paru fort élastique ?
Des scrupules honorables des uns et des autres, il résulte qu’en amont on laisse avancer les gens sous prétexte, justement, qu’ils sont en formation, en espérant qu’il se trouvera bien quelqu’un pour les arrêter le jour où leur incompétence sera tout à fait établie ; et qu’en aval, on se dit qu’on n’aurait pas laissé les étudiants s’avancer autant dans le parcours de formation s’ils avaient un niveau clairement insuffisant ; de toute façon au vu de leur investissement, on pense qu’il n’est plus temps de les éliminer. Les formateurs sont souvent pris au piège des idées qu’ils professent : au nom d’une pédagogie de la réussite, ils laissent aller jusqu’à la certification des personnes qui ne la pratiqueront jamais ! La solution élégante consisterait à pratiquer une évaluation formative et à construire vraiment les compétences manquantes. Hélas, les cursus de formation permettent rarement des solutions aussi souples et différenciées.
Il serait tentant de se draper dans une vertueuse indignation et d’affirmer qu’une formation " digne de ce nom " ne certifie que des enseignants absolument compétents. Toutefois, c’est en entretenant de pareilles fictions qu’on sombre dans la pensée magique. Souvenons-nous plutôt que le pouvoir d’évaluer n’est pas plus facile à exercer durant la carrière professionnelle qu’en formation initiale et que les même dilemmes, parfois de plus graves, guettent ceux qui veulent évaluer les compétences des professionnels en exercice !
En début de carrière, les procédures d’évaluation les plus sérieuses sont en définitive, hélas, les plus dures pour les intéressés : engagement dans un statut précaire et stabilisation si et seulement si les compétences sont dûment attestées après une ou plusieurs années de pratique.
La vie continue
À supposer qu’en fin de formation initiale l’évaluation certificative soit rigoureuse et ne mette sur le marché du travail que des débutants compétents, le problème ne serait qu’à moitié résolu, car au cours du cycle de vie professionnel, les compétences ne restent pas figées, elles se développent ou régressent, s’élargissent ou se rétrécissent (Huberman, 1989 b). Deux processus contradictoires sont à l’œuvre :
Si l’école, ses programmes, son fonctionnement et son public ne changeaient pas, on verrait ces deux tendances s’affronter, et faire pencher la balance dans un sens ou l’autre, en fonction de l’énergie, du rapport au métier, de la propension à se poser une question existentielle : " Vais-je mourir debout, au tableau noir, une craie à la main ? " (Huberman, 1989 a). L’évolution de l’école brouille les cartes et oblige chacun à maints recommencements, parce que les élèves, les familles, la culture, la société ont changé.
Imaginons un enseignant dont la formation initiale a été certifiée en 1976. Il a traversé vingt ans de la vie du siècle et a dépassé la quarantaine. Il a donc encore autant d’années de travail devant soi. Comment accorder quelque crédit à sa lointaine certification ? Tant de choses sont arrivées depuis, dans le système comme dans sa vie personnelle et professionnelle, qu’on ne peut imaginer l’enfermer à jamais dans une image de ses compétences établies 20 ans plus tôt. L’évolution peut aller dans l’un ou l’autre sens : des enseignants jugés très compétents en début de carrière peuvent sombrer dans une pratique minimaliste, frontale, peu inventive et inefficace, alors que des débutants qui survivaient avec peine, à force de travaillé sur leurs difficultés, deviennent des experts, à l’image de ces enseignants qui, par divers accidents de l’histoire, ont été engagés sans véritable formation initiale et figurent parmi les plus compétents de leur génération.
La certification à l’entrée dans le métier n’est donc pas entièrement fiable, mais cela n’a pas nécessairement de conséquences graves, puisque les acquis initiaux ne sont qu’un des déterminants des compétences dix ou vingt ans plus tard. On tend toujours à surestimer l’importance de la formation initiale. Dans un système éducatif et une société en transformation, elle n’est que le point de départ d’une longue histoire, au gré de laquelle bien d’autres facteurs vont influencer les représentations du métier, l’identité de l’enseignant, ses savoirs professionnels et ses compétences.
Les limites de l’autoévaluation et de la coévaluation
Parmi les compétences attendues d’un véritable professionnel, il y a certainement la capacité de s’autoévaluer et de se former dans les domaines où il se sent moins solide, et celle d’évaluer ses collègues et de leur transmettre un message constructif les incitant à se perfectionner ou simplement à réfléchir à leur pratique. Sans mettre en doute l’utilité de ces modes de régulation, on peut douter de leur généralité.
Une improbable autorégulation
Dans le meilleur des mondes, la compétence professionnelle serait garante d’elle-même et il n’y aurait nul besoin d’introduire une évaluation des compétences. Hélas, nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. Sans doute, pour une partie des professionnels, un système d’évaluation externe des compétences pourrait sembler superflu, dans la mesure où ils portent en eux une forte capacité d’autoévaluation, d’autorégulation et d’autoformation. Ce n’est pas la règle commune. N’affirmons pas trop vite qu’un enseignant " digne de ce nom " s’évalue, se forme et n’a donc nullement besoin qu’on mette en place un système d’évaluation externe. Un peu de réalisme psychosociologique ne saurait nuire : dès l’enfance, nous apprenons tous qu’il faut avoir l’air plus compétents que nous ne sommes pour être aimés, félicités, récompensés, ou tout simplement pour avoir la paix et une certaine liberté. L’école renforce ce curriculum caché et le monde professionnel ne nous enseigne pas autre chose. Chacun serait ravi d’être compétent. Là n’est pas le dilemme. Comme le dit volontiers Philippe Meirieu, tous voudraient savoir, mais chacun n’est pas prêt à apprendre. Construire des connaissances prend du temps et de l’énergie, confronte à soi-même et exige une persévérance et une discipline dont nous ne sommes pas toujours capables ; développer nos compétences promet un éventuel bénéfice à long terme, mais nous prive à coup sûr, dans l’immédiat, de temps libre et d’activités agréables. Potasser son vocabulaire allemand ou regarder la télévision ? faire ses exercices de mathématique ou rejoindre les copains ? Qui, enfant ou adolescent, n’a jamais hésité et choisi parfois la facilité ? Les adultes sont-ils bien différents ?
Plusieurs mécanismes endogènes peuvent équilibrer notre goût de la paresse, par exemple :
Heureusement, ces moteurs ne sont pas rares et portent une partie des professionnels à entretenir et à développer leurs compétences. Même alors, les effets peuvent être très sélectifs et ne pas garantir le niveau de compétence attendu par l’institution. La conscience morale, l’orgueil ou la passion d’apprendre ne vont pas nécessairement de pair avec la lucidité. Un enseignant peut passer des jours entiers à se perfectionner en géographie ou en grammaire, parce que cela l’intéresse ou parce qu’il estime qu’il doit être irréprochable, sans voir que ses failles sont d’ordre didactique ou relationnel. La volonté ou l’envie d’apprendre ne suffisent pas, si elles ne sont pas guidées par une perception précise de ce qu’on sait faire et de ce qu’on devrait savoir faire.
Par ailleurs, pour une partie des professionnels, ces moteurs ne fonctionnent jamais ou tombent rapidement en panne : il arrive un moment de la vie où le sens du devoir s’affaiblit, où le plaisir de la découverte s’estompe, où l’énergie vitale diminue. Il serait bien hâtif de jeter la pierre à quiconque : il y a certes des cyniques, des " fumistes ", des escrocs dans tous les métiers, mais il y a aussi des gens dont la vie privée est difficile, qui ont des problèmes de santé ou d’argent, dont les proches ne vont pas bien ou qui ont, pour d’autres raisons, perdu le goût de vivre ou d’apprendre, se sont repliés sur eux-mêmes ou n’ont plus une identité assez forte pour s’investir dans leur travail.
Nous savons notre infinie capacité à nous illusionner sur nous-mêmes, à nous donner raison, à ne pas voir les failles qu’un observateur un peu expérimenté perçoit au premier coup d’œil. Il n’y a donc pas de régulation automatique. Nous sommes assez habiles pour " arranger " la réalité de sorte qu’elle soit acceptable. Dans tous les métiers, il y a donc à la fois des professionnels compétents et conscients de l’être, d’autres qui se sous-estiment ou se surévaluent, et d’autres encore, qui savent leurs limites, mais n’ont pas pour autant la force, l’orgueil, le courage de se mobiliser.
Une évaluation mutuelle prudente
Pouvons-nous compter sur les autres pour renforcer nos capacités d’autoévaluation ? Seulement jusqu’à un certain point et sous certaines conditions :
•Entre les êtres humains, il existe une immense complicité pour se renforcer mutuellement dans que chacun est " à la hauteur ". Pour se couper d’un groupe uni, il suffit d’insinuer que l’un de ses membres n’est pas irréprochable ; aussitôt, on devient celui qui juge, " se prend pour quelqu’un ", donne des leçons ou verse dans la pensée négative. Il n’est pas plus facile de mettre en avant ses propres doutes ou limites : c’est ainsi que dire à haute voix, dans une salle des maîtres, qu’on ne sait pas pratiquer une évaluation formative ou différencier son enseignement peut susciter soit un rejet agressif, soit une dénégation navrée " Parle pour toi. Nous ne sommes pas concernés. Si tu veux t’avouer incompétent, c’est ton problème ".
•Au sein d’une équipe pédagogique, le contrat de coopération peut autoriser une évaluation mutuelle, mais chacun " marche sur des œufs " et réfléchit à deux fois avant de porter un jugement. Il sait d’expérience que, même lorsqu’un collègue lui demande de dire " sincèrement " ce qu’il pense de sa façon de faire, il en espère une appréciation positive et ne lui sait que modérément gré d’une évaluation critique. Les blessures narcissiques peuvent détruire la relation et une équipe pédagogique ne dure que si ses membres ont, entre autres choses, appris la prudence dans leurs jugements mutuels.
On peut espérer que trois processus modifieront progressivement la situation :
- l’émergence d’une culture professionnelle de l’évaluation, permettant d’entendre des commentaires critiques sans " se décomposer ", en dissociant progressivement la personne de ses actes. Les pilotes, les athlètes, les musiciens ont intégré la critique par les pairs aux routines de travail, sans toujours la vivre sereinement ; pourquoi les enseignants n’y parviendraient-ils pas ?
- la définition de contrats de coopération professionnelle fixant des règles du jeu, assurant une forme de réciprocité dans la critique, garantissant le droit de s’expliquer et de demander à l’autre de nuancer ou réviser son jugement ; ce qui fait peur, souvent, ce n’est pas la critique, mais le fait qu’elle entraîne rejet, exclusion, malaise ou conflit, qu’elle perturbe la relation sans faire bouger les représentations et les pratiques, faute d’être réglée par un contrat explicite ;
- le passage à une formation plus substantielle à l’autoévaluation, à l’intervision et plus globalement à une pratique réflexive, individuelle et collective.
L’évolution est amorcée, voire avancée, ici ou là. Même si on peut attendre des progrès dans ces trois directions, ils ne dispenseront pas d’une prise en charge institutionnelle de l’évaluation des compétences.
À qui appartient-il d’évaluer les compétences ?
Une prise en charge institutionnelle n’équivaut pas, ipso facto, à une " inspection par la hiérarchie ". Il s’agit plutôt d’affirmer que l’autoévaluation et la coévaluation spontanées, aussi bienvenues soient-elles, ne suffisent pas à réguler la mise à jour des compétences et qu’il faut donc que " l’institution s’en mêle ".
L’institution est, traditionnellement, assimilée au " pouvoir organisateur " de l’école. Toutefois, plus on va vers la professionnalisation de l’enseignement, plus la responsabilité de l’évaluation des compétences peut être l’effet d’une synergie entre l’administration scolaire et des représentants de la profession. Il importe en tout cas de dissocier le principe d’une évaluation institutionnelle des compétences de ses modalités. L’attribution de tâches et de pouvoirs d’évaluation à des acteurs déterminés est un choix crucial, à peser très soigneusement.
Auparavant, posons un postulat : l’évaluation institutionnelle ne devrait intervenir que pour suppléer aux limites de l’autoévaluation ou de l’évaluation mutuelle. Si des processus spontanés de régulation sont à l’œuvre, l’institution et la corporation se borneront à les soutenir. Le rôle d’une évaluation externe ne devient irremplaçable que lorsque ces processus sont absents ou trop hésitants.
Qui doit alors intervenir ? Trois modèles connus sont en concurrence :
Chacun de ces modèles a des points forts et des points faibles.
L’évaluation par un corps d’inspection
Ce modèle, le plus classique, a les défauts de ses qualités. Il est, du moins sur le papier, sans ambiguïté ; les inspectrices et inspecteurs ont un statut d’autorité, qui leur donne le droit d’entrer dans les classes, d’observer, d’évaluer, de dire ce qu’ils pensent et de donner des directives incitant fermement le praticien à affiner ou moderniser ses pratiques, au besoin en suivant une formation. Cette clarté du rôle a une conséquence paradoxale : assignés à être observés et évalués, les enseignants ne se sentent nullement obligés à la transparence, ils cherchent plutôt, très normalement, à faire bonne impression. Dans les systèmes qui connaissent la notation, l’enjeu de l’inspection est d’être " juste assez bon " pour ne pas se voir refuser une notation correcte. Dans les autres systèmes, c’est de ne pas attirer l’attention. On se trouve dans le jeu classique du chat et de la souris, qui n’est pas un jeu coopératif. Si l’inspecteur a beaucoup de temps et de persévérance, il peut aller au-delà des apparences, car il est difficile de faire illusion plus de quelques heures. Dans plusieurs systèmes scolaires, leurs autres tâches et le nombre d’enseignants dont ils sont responsables, semblent obliger les inspecteurs à ne faire que des visites éclairs, très espacées, au cours desquelles ils ne peuvent détecter (ou confirmer) que des dysfonctionnements majeurs. Même lorsqu’ils voient des choses plus subtiles, le temps leur manque pour les vérifier et faire partager leur analyse à l’intéressé.
Plusieurs facteurs plus récents rendent cette forme d’évaluation encore moins efficace :
Ces constats appelleraient mille nuances. Il existe certainement des inspectrices et des inspecteurs respectés, sûrs d’eux et de leur conception du métier et assez courageux pour oser évaluer les compétences des enseignants, dire quand ça ne va pas et assumer le rôle ingrat et délicat de celui qui avance une critique forte et met l’enseignant en demeure de se former. Si cela fonctionnait à large échelle, le problème de l’obligation de compétence et de son contrôle serait résolu, et cela se saurait…
On peut faire la même analyse pour les chefs d’établissements lorsque leur mandat leur confère des fonctions d’inspection ou d’évaluation des personnels dont ils ont la charge. Proviseur d’un lycée français, chargé d’évaluer ses professeurs, Michel Mazeran en témoigne :
Il est des moments dans la vie d’un chef d’établissement, où même l’individu le plus imbu de l’importance de sa mission peut être gagné par le doute : c’est la période de la notation des personnels. Chacun d’entre nous déploie alors des trésors d’habileté pour confectionner les formules les plus vides de sens, encore qu’il soit vrai qu’un sens codé, accessible aux seuls initiés de ce langage ésotérique, auprès duquel la langue de bois est d’une limpidité durasienne, se cache parfois dans les replis de phrase apparemment passe-partout.Ainsi, il est courant que " donne satisfaction " signifie qu’en fait celui dont on parle est bien médiocre, mais meilleur, tout de même, que celui qui " donne globalement satisfaction ", car sous ce constat, anodin en apparence, se cache la dénonciation de l’incurie la plus totale. J’ai pour ma part averti les enseignants de mon établissement que je n’écris pas ce que je ne pense pas, ce qui ne signifie pas, ils l’ont bien compris, que ce que je pense puisse toujours être écrit. On joue donc chaque année à ce que Célimène exposait si bien dans le Misanthrope, de même que " la malpropre sur soi, de peu d’attraits chargée " devenait, transformée par le regard amoureux, une " beauté négligée ". L’incapable, celui à qui vous ne confieriez pour rien au monde votre enfant, devient, par la grâce de la muse de la prose administrative, un " enseignant consciencieux ". Le terroriste, dont la pédagogie tient plus du maintien de l’ordre que de l’ouverture à la culture, est " soucieux de faire progresser ses élèves ", pendant que les nombreux enseignants que vous souhaiteriez remercier, d’un éloge sincère, pour le travail remarquable qu’ils accomplissent sont obligés de se contenter de deux lignes qui tiennent plus de la notice nécrologique dans le journal local que de l’expression de votre gratitude (Mazeran, 1995, p. 2).
Mazeran l’affirme " la cérémonie désuète de l’inspection doit céder la place à un dialogue fructueux consécutif à une visite et mettant en lumière les écarts entres les compétences déjà acquises et les autres " (ibid, p. 3). Mais s’il y a cérémonie, n’est-ce pas pour conjurer la difficulté d’une évaluation formative inscrite dans un rapport d’autorité ?
L’évaluation par un corps de conseillers pédagogiques
Comment intervenir auprès d’un enseignant qui n’a rien demandé ? Tel est le dilemme du conseiller pédagogique sans autorité hiérarchique, tel qu’il est connu au Québec ou dans le canton de Vaud. Même si l’institution lui donne le droit et le mandat de se rendre dans les classes, il hésitera à user de cette prérogative s’il ne se sent pas le bienvenu. On peut donc comprendre qu’un conseiller pédagogique soit porté, au fil des années, à travailler en priorité avec ceux qui le sollicitent et l’impliquent dans leurs projets d’innovation, et de moins en moins avec ceux qui n’ont qu’un désir : se faire oublier.
Ici encore, un conseiller pédagogique particulièrement consciencieux et téméraire peut s’aventurer dans des classes en forçant un peu la porte. S’il est très compétent et si l’enseignant n’est pas totalement sur la défensive, cela peut élargir le cercle des enseignants entrant en dialogue avec lui. On peut douter que cette fonction permette d’atteindre et de faire bouger individuellement les enseignants qui en auraient le plus besoin. C’est pourquoi elle s’oriente assez souvent vers des tâches - au demeurant fort utiles - de développement et d’animation pédagogiques, au niveau de l’établissement ou du système éducatif, en abandonnant le terrain des visites de classes et du dialogue singulier avec un enseignant à propos de sa pratique. Tout se passe comme si les systèmes éducatifs, lorsqu’ils élaborent des cahiers des charges, faisait preuve d’un volontarisme irréaliste et sous-estimaient l’extrême difficulté de faire usage de toutes les prérogatives d’un rôle professionnel, quel qu’il soit. Les transactions entre acteurs, dont dépend leur coexistence pacifique, exigent en effet, informellement, que chacun ne pousse pas systématiquement son avantage aussi loin que les textes l’y autorisent.
L’évaluation par des collègues expérimentés et mandatés
Dans un tel dispositif, c’est en général à un collègue d’une autre école qu’il convient d’ouvrir sa classe. Celui-ci ne vient pas de son propre chef, mais dans le cadre d’un mandat pour lequel il s’est porté volontaire. Ce mandat est donné par l’institution, mais son principe gagne à être concerté avec les associations professionnelles.
Il y a alors extériorité de l’évaluateur en même temps qu’égalité de statut hiérarchique. Cela rend-il la relation plus confiante ? Tout dépend des enjeux. Si l’évaluation reste purement formative, on peut imaginer qu’une partie des enseignants acceptent la visite d’un collègue et ses commentaires " critiques mais constructifs ", à condition que cela reste entre eux. Si l’évaluation débouche sur des conclusions destinées à être communiquées à d’autres niveaux de l’organisation scolaire et surtout sur des injonctions, il est peu probable que le statut de collègue suffise à rendre acceptable ce qui ne l’est pas venant d’un inspecteur ou d’un conseiller pédagogique.
Les difficultés sont donc en partie les mêmes. C’est cependant l’une des voies les moins explorées et qui mérite donc d’être envisagée, même s’il ne faut pas en attendre des effets miraculeux. Si un évaluateur suscite de l’hostilité, cela peut tenir à son statut, et de ce point de vue un collègue est moins menaçant qu’un supérieur hiérarchique ou un spécialiste qui n’a pas de classe. Cela ne devrait pas masquer l’essentiel : nul n’aime être observé et évalué s’il sent que cela peut tourner à son désavantage, que ce soit dans des domaines très concrets (notation, stabilisation, avancement, revenu) ou dans un registre plus symbolique. Un acteur a du mal à ne pas traiter comme un adversaire, voire un ennemi, celui qui a le pouvoir de l’évaluer et, s’il ne répond pas aux exigences, de lui compliquer la vie et de lui infliger une blessure narcissique. Le crédit dont bénéficie a priori un pair réputé bienveillant peut faire place à une conduite défensive dès le moment où il joue un rôle d’évaluateur. On peut même, au moment où les choses tournent mal, regretter de ne pas avoir à faire à quelqu’un qui " n’y connaît pas grand chose ". Un enseignant sévèrement jugé par sa hiérarchie parvient en effet à maintenir intacte son estime de soi en déniant toute compétence à son juge. Il est difficile de se défendre aussi facilement contre le jugement d’un collègue jouissant de l’estime de la corporation.
Sommes-nous dans une impasse ?
Sommes-nous devant une mission impossible ? Il se peut - la lucidité commande d’envisager cette éventualité - qu’il n’y ait aucune réponse vraiment satisfaisante au problème du contrôle des compétences, dans l’état présent des mentalités et des rapports de force, du moins dans le cadre de la fonction publique. On se trouve en effet dans une situation de transition où le corps enseignant revendique une autonomie qu’il n’assume pas vraiment, où l’autorité n’est plus assez légitime pour incarner la norme et entamer souvent une épreuve de force, où la professionnalisation est assez avancée pour " délégitimer " toute forme de contrôle externe, mais pas assez pour que les professionnels prennent le relais.
Ce pessimisme quant à la recherche d’une solution vraiment convaincante n’empêche pas de travailler à un progrès. Chacune des formules passées en revue, en dépit de ses limites, accomplit une partie de la tâche. On pourrait viser à les améliorer et à les compléter. Plutôt que de chercher un système unique, mieux vaudrait faire coexister plusieurs modalités et plusieurs réseaux d’évaluation externe.
On pourrait aussi tenter de poser le problème en d’autres termes. Jusqu’ici, le contrôle des compétences a été placé implicitement dans le cadre d’une rencontre - et parfois d’un duel - entre l’évaluateur et l’évalué, avec un enjeu institutionnel, une forme de certification des compétences à l’égard de tiers. Et si l’on concevait plutôt un dialogue formatif ? Il pourrait s’établir à la fois :
Cela supposerait une évolution des modes de gestion du système éducatif, amorcée, mais encore bien fragile, et l’émergence de rôles et de contrats nouveaux. Est-ce une voie d’avenir, du point de vue de l’obligation de compétences et de son contrôle ? ou une façon nouvelle de " noyer le poisson " ? Pour le savoir, il faut s’avancer un peu plus loin dans la description de dispositifs alternatifs. Ce sera l’objet d’un nouvel article.
J’ai plaidé, à partir de l’expérience conduite dans l’enseignement primaire genevois, pour une formation continue explicitement orientée vers le développement de compétences professionnelles identifiées (chapitre I). Il eut été possible d’en rester là, c’est-à-dire dans le meilleur des mondes : des compétences étant définies, des offres de formation seraient faites dans ce sens, et chacun " ferait ce qu’il a à faire ", sans que l’institution ait à se préoccuper du contrôle et de l’évaluation des compétences.
Cette perspective positive rencontre deux obstacles :
1. L’idée même qu’il faille évaluer des compétences n’est pas acquise. Hutmacher (1996) montre qu’un quart seulement des enseignants pensent avoir des comptes à rendre à l’institution et à la société. Les autres se sentent responsable devant les parents (25 %), les enfants ou les élèves (30 %), les collègues (3 % !) ou eux-mêmes (17 %). Lorsqu’elle se décide à affronter le problème, l’école oscille entre une impossible obligation de résultats et une stérile obligation de procédure. J’ai proposé de sortir de ce dilemme en allant vers une véritable obligation de compétences (chapitre II). Pour cela, il faut rompre :
Honorer une obligation de compétence, c’est " faire tout ce qui est humainement et professionnellement faisable ", sans être condamné à réussir, mais sans pouvoir se protéger derrière la formule bureaucratique " J’ai observé le règlement à la lettre, on ne peut rien me reprocher ". Un défaut de compétence n’est pas de l’ordre d’une infraction à une règle. C’est une réponse décevante à une attente légitime à l’égard du professionnel : qu’il fasse preuve de discernement, de jugement, d’esprit d’initiative et de décision, d’efficacité dans l’identification et la résolution des problèmes et de respect d’un code éthique (la fin ne justifie pas tous les moyens).
2. Même lorsqu’on opte pour une obligation de compétences, c’est un principe plus facile à énoncer dans l’abstrait qu’à mettre en œuvre. Les difficultés intrinsèques d’une évaluation des compétences (Demers, 1995 ; Mazeran, 1995, Pion, 1995 ; Tardif, 1996) se conjuguent inextricablement au fait que les enseignants ne tiennent pas à être évalués et que nul acteur du système n’est assez " suicidaire " pour engager un rapport de force à ce propos, ni localement, ni à l’échelle de l’organisation scolaire. L’autoévaluation et la coévaluation, aussi souhaitables soient-elles, ne sont pas spontanément pratiquées par tous. Il y a donc nécessité d’une évaluation institutionnelle ; or, cette dernière est en quête d’acteurs (chapitre III) : les inspecteurs n’ont plus guère envie d’inspecter et rêvent de devenir gestionnaires ou animateurs ; les conseillers pédagogiques préfèrent l’animation globale et l’accompagnement d’équipes dynamiques au dialogue tendu avec des praticiens ; quant aux systèmes d’évaluation par des pairs, ils sont prometteurs et méritent d’être développés, mais ils butent aussi sur la résistance active ou passive de ceux qui ont tout à perdre d’un contrôle régulier des compétences.
Le changement comme enjeu du contrôle des compétences
Sommes-nous dans une impasse ? Je n’exclus pas une conclusion pessimiste : toute pratique n’est pas évaluable correctement hic et nunc ; elle l’est sans doute dans l’absolu : il n’est jamais impensable d’établir des critères, de mener des observations, de les interpréter et de conclure à la présence ou à l’absence de certaines compétences professionnelles. Toutefois, tout ce qui est pensable n’est pas praticable lorsque cela concerne des personnes, membres d’une corporation, dans le cadre d’un contrat et de rapports de travail.
Une interaction coopérative
L’évaluation des compétences suppose la coopération active des intéressés et ne peut se faire à leur corps défendant. On peut éventuellement mesurer les acquis de leurs élèves à leur insu ou contre leur gré, sur la base d’examens, d’épreuves communes ou encore des notes et travaux qu’ils rendent à l’autorité scolaire. La conformité des enseignants aux procédures prescrites suppose une observation dans leur classe, mais elle peut à la rigueur se faire dans le cadre d’une obligation administrative : en consultant le journal de classe, les cahiers, les carnets, en inventoriant les moyens d’enseignement disponibles, en surveillant les horaires et les absences, en évaluant l’avancement dans le programme, en s’informant sur la quantité de devoirs donnés à domicile, en examinant quelques leçons, un inspecteur expérimenté peut apprécier la conformité d’un enseignant aux règles en vigueur.
Pour évaluer des compétences, il ne suffit pas d’observer un moment, il faut s’installer plus longuement dans la classe et surtout parler avec l’enseignant de façon non défensive. La compétence ne saurait s’établir uniquement en fonction de ce qu’il fait ou de la manière dont il le fait. Il faut comprendre pourquoi l’enseignant fait ce qu’il fait, comment il raisonne, de quelles données il dispose, ce qu’il tente de comprendre ou de réaliser. Du fait que, durant une matinée, il n’interroge jamais un élève en difficulté, peut-on conclure qu’il ne s’y intéresse pas ? Pourquoi ne pas envisager que c’est une feinte indifférence, qui fait partie d’une stratégie ? Si l’enseignant ne réprime pas tout bavardage intempestif, est-ce parce qu’il est laxiste ou parce qu’il veut construire une relation pédagogique qui ne soit pas constamment cassée par de petites interventions répressives ? Lorsqu’il ne contrôle pas tout, est-ce un manque de sérieux ou une preuve de confiance ? Le sens de l’action pédagogique ne se donne pas à voir de façon simple et univoque, parce que chaque événement appartient à une histoire que l’observateur ignore et parce que les gestes professionnels s’inscrivent parfois dans une stratégie à long terme, souvent dans une intention et une tactique à plus courte échéance, qui ne sont ni les unes ni les autres facilement décodables à partir des seules observations, mêmes fines, d’un visiteur d’un jour. Derrière toute pratique, il y a des conceptions de l’apprentissage, des théories didactiques, des valeurs, une interprétation des programmes et des finalités de l’école, une vision de la relation pédagogique, une idée des mobiles et des modes de fonctionnement des élèves, bref des raisonnements et des choix qui orientent et expliquent l’action. Pour avoir accès à ces clés, il faut entamer une conversation assez confiante pour que l’enseignant s’expose. S’il craint que ses propos soient reçus selon le principe " Tout ce que vos direz peut être utilisé contre vous ", comment imaginer qu’il aide quiconque à comprendre quelque chose à sa pratique, donc à jauger ses compétences ?
Certains cas sont si limpides qu’on peut conclure à l’incompétence en passant une heure dans une classe ou en recueillant quelques témoignages. Sans doute est-ce vrai lorsqu’il y a total amateurisme ou faute professionnelle majeure, souvent dans un contexte plus chargé : absentéisme chronique, alcoolisme, toxicomanie, pédophilie, violence. Qu’on puisse alors intervenir et sévir, même sans la coopération de l’enseignant incriminé, fort bien. Mais de tels cas sont marginaux et relèvent de la médecine du travail ou des mœurs presque autant que de la pédagogie. Le contrôle des compétences serait bien pauvre s’il n’opérait que dans les cas tellement déviants que chacun voit à l’œil nu qu’il y a un gros problème.
Des exigences discutables et discutées
L’enjeu de l’évaluation des compétences n’est pas seulement de détecter des enseignants qui transgressent des règles élémentaires et méritent donc des sanctions. Ce n’est pas alors une question de compétence, mais de respect du cahier des charges et des obligations imposées par la législation ou l’appartenance à une organisation. L’enjeu majeur est d’entrer en dialogue avec des enseignants honnêtes, sérieux, voire consciencieux, mais qui pratiquent une pédagogie rigide, faiblement différenciée, inutilement autoritaire, mal maîtrisée, donc peu efficace, peu propice au développement et aux apprentissages. De tels enseignants ne sont pas " hors-la-loi ", ils sont simplement en deçà du niveau de compétence attendu.
Qui décide des critères en fonction desquels on juge qu’un enseignant n’est pas ou n’est plus " à la hauteur " ? Certains enseignants sous-estiment les exigences du système ou les méconnaissent, parfois parce qu’elles sont très vagues, sont en train de changer ou sont fortement controversées. D’autres les perçoivent assez bien, mais n’y adhèrent pas, parce qu’ils refusent les politiques de l’éducation, les programmes et les orientations didactiques qui les fondent. La complexité du métier et les ambiguïtés des organisations scolaires permettent de présenter tout défaut de compétence comme un rejet respectable d’exigences jugées excessives ou illégitimes. Même lorsqu’un manque de compétence a de tout autres sources, il est plus facile de le justifier en le présentant comme une résistance à la mode, aux politiques en vigueur, aux réformes " aberrantes ".
Cela complique singulièrement le tableau. Dans certains métiers, l’incompétence ne peut se déguiser aussi aisément sous les apparences du bons sens pédagogique, de la fidélité aux " traditions qui ont fait leur preuve ", du dédain des modes ou du refus des " pseudo inventions prétentieuses des spécialistes ou des chercheurs ". On peut aussi se défendre en niant l’existence ou l’ampleur des problèmes qui appellent des compétences nouvelles, on peut par exemple minimiser l’importance de l’échec scolaire, des mouvements migratoires, de la violence, ou dégager la responsabilité de l’école. C’est ainsi qu’on peut refuser toute légitimité aux compétences requises en matière de différenciation ou d’instauration d’un contrat social de non violence dans l’école, en définissant le rôle du maître comme celui qui enseigne à des élèves motivés, correctement socialisés et aptes à suivre le programme, en rejetant toute les responsabilités sur la famille ou les collègues si ces conditions ne sont pas réunies.
Le manque de compétence est toujours difficile et douloureux à reconnaître et chaque praticien en difficulté, quel que soit son métier, cherchera dans un premier temps à se trouver des excuses et à légitimer son incompétence en invoquant le droit à la différence ou à la libre expérimentation. Certains métiers semblent toutefois plus propices que d’autres à de tels tours de passe-passe. On voit mal un médecin justifier une erreur professionnelle au nom d’une conception personnelle de la santé. Certes, il existe une marge d’appréciation, autour des traitements ou des opérations à hauts risques, par exemple, mais sans commune mesure avec la latitude qu’on se donne en pédagogie. Sans doute cela tient-il à la fois au développement limité des sciences de l’éducation aussi bien qu’au rapport qu’entretiennent nombre d’enseignants aux savoirs issus de la recherche ou de l’expérience des autres. Cela se passerait différemment dans un métier dont la professionnalisation serait plus avancée, où chacun ne se sentirait pas libre de dire à propos de n’importe quelle question " C’est mon opinion et je la partage ". Mais telle est la situation aujourd’hui.
Une évaluation négociée
Qu’en conclure ? Que l’évaluation des compétences professionnelles des enseignants n’est pas facilement réalisable sur le modèle de métiers où la part de la rationalité technique ou scientifique prédomine, par exemple les pilotes de ligne. À tout moment de leur carrière, ils sont évalués par un expert qui est aussi un collègue. Il ne le vivent pas confortablement, d’autant que les enjeux sont majeurs, avec le risque de perdre ou de ne pas gagner l’autorisation de voler sur certains appareils, donc certaines lignes. Pourtant, cela fonctionne et cela paraît " normal ", à la fois parce que c’est intégré au contrat de travail et parce que les critères paraissent pour la plupart légitimes, même lorsqu’ils sont défavorables. Rien n’est en effet plus facile que d’adhérer à des normes de qualité face auxquelles on fait bonne figure. La légitimité des critères se mesure lorsqu’il y a confit entre l’envie d’être jugé favorablement et une exigence qui vous met en difficulté.
Je n’en déduis pas que l’évaluation des compétences est impossible, mais qu’elle doit nécessairement :
Ce dernier point est essentiel : si l’évaluation ne permet pas le changement, elle suscite le conflit ou la régression.
On peut, à propos des compétences des personnes, épouser la thèse selon laquelle " L’efficacité des établissements ne se mesure pas : elle se construit, se négocie, se pratique et se vit " (Gather Thurler, 1994).
Concrètement, quels dispositifs mettre en place ? Je propose d’investir :
Inciter à la professionnalisation interactive
L’idéal serait que chacun évalue ses compétences comme son état de santé, parce qu’il y a intérêt, parce que cela lui paraît de l’ordre d’une régulation élémentaire de l’écart entre ses projets et son action effective. Quiconque apprend une langue parce qu’il en a besoin dans sa vie professionnelle ou privée progresse plus en quelques mois que durant des années de cours de langue à l’école. Cela vaut de tout apprentissage. La différence, c’est que si quelqu’un n’apprend pas une langue et se trouve le seul à en souffrir ou à en pâtir, cela reste son problème. Dans une organisation qui voudrait que tous ses employés apprennent des langues étrangères, le problème de la direction serait : comment faire pour leur en donner envie plutôt que de l’imposer ?
Par des incitations financières, répond souvent le monde de l’entreprise. Transposé au monde de l’éducation, cela conduit au fantasme de quelques administrations scolaires aux idées courtes : le " salaire au mérite ". La volonté d’équité pousserait inévitablement à définir et à mesurer le mérite de façon tellement bureaucratique qu’on imagine mal qu’il puisse conserver quelque rapport avec une véritable évaluation des compétences en termes d’efficacité pédagogique. De là à récompenser la docilité, le pas est vite franchi. Mais là n’est pas l’essentiel : il est vain de croire qu’on peut, dans un métier de l’humain, fonder la recherche d’efficacité sur l’appât du gain. La raison est aussi simple que fondamentale : quiconque serait mû avant tout par ce mobile aurait dû choisir un autre métier. S’il est tout de même devenu enseignant, on peut douter de sa capacité de s’engager dans une relation pédagogique et didactique féconde, qui suppose une forme de générosité, de refus du marchandage.
Dans un métier de l’humain, ce qui pousse les gens à se surpasser n’est pas toujours désintéressé. On peut trouver une profonde satisfaction narcissique à éduquer et instruire, à se sentir à fois utile et nécessaire. Le moteur le plus sûr du développement des compétences d’un enseignant, c’est le surcroît de sens, d’identité, de maîtrise et de plaisir professionnels qu’il en attend. Tout cela peut s’enraciner dans la satisfaction du devoir accompli, dans la lutte militante pour une bonne cause ou dans des enjeux plus personnels.
S’il en allait ainsi pour tous les professionnels, chacun travaillerait spontanément à évaluer et développer ses compétences, à la manière d’un athlète ou d’un artiste. Puisque ce n’est pas le cas, la question devient : comment atteindre ceux qui ne sont pas spontanément prêts à réfléchir sur leur pratique et à progresser, ceux dont ce n’est pas la façon ordinaire de vivre ? Certainement pas en les assujettissant à des procédures formelle d’évaluation et de notation, mais plutôt en les impliquant dans diverses formes de professionnalisation interactive.
Monica Gather Thurler (1996 a) la définit comme l’un des sommets d’un triangle :
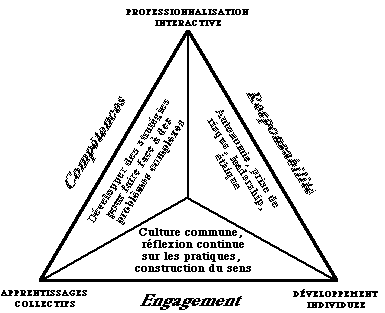
On le voit, ce modèle reste assez abstrait en ne renvoie pas à un dispositif unique, mais à l’ensemble des formes d’interaction et de coopération entre enseignants qui soient susceptibles de favoriser la pratique réfléchie et la professionnalisation, de stimuler des synergies entre développement personnel et travail collectif. On pensera notamment à l’implication dans :
Il n’est ni nécessaire ni possible que chacun soit constamment impliqué dans toutes ces modalités de professionnalisation interactive. Il reste cependant à sortir d’un cercle vicieux connu : la même minorité active s’implique dans la plupart des activités mentionnées, alors qu’une large majorité ne participe à aucune ou presque.
Sans doute pourrait-on envisager d’intégrer au cahier des charges de chacun non seulement le souci de se former (qui n’impose pas de suivre la formation continue), mais la responsabilité de s’engager fortement selon l’une au moins des modalités envisagées, en considérant que " cela fait partie du job ", qu’on a le choix de la modalité, mais pas le droit de ne s’impliquer dans aucune modalité de professionnalisation. On pourrait s’inspirer de ces écoles qui imposent la pratique suivie et sérieuse d’un sport ou d’un instrument de musique, mais laissent toute liberté quant au choix du sport ou de l’instrument.
Ici encore, cependant, mieux vaut parier sur l’incitation. C’est une des fonctions importantes des cadres : aider les boulimiques du travail collectif et de la militance, à se protéger du burn out et encourager les autres à s’engager davantage. Les différences entre établissements ou circonscriptions sont à cet égard spectaculaires, selon que le responsable ne se sent pas concerné ou, au contraire, ne perd aucune occasion de pousser les enseignants à s’engager, à prendre des responsabilités et le risque de se confronter à des défis et à des collègues. Le thème de l’empowerment est d’actualité dans les travaux sur l’innovation et la professionnalisation (Gather Thurler, 1996 a). Or, pour prendre du pouvoir, il faut, paradoxalement, au moins au début, y être invité dans un système qui a longtemps envoyé le message : " Chacun à sa place ! ". Une autorité qui craint le changement n’a aucun intérêt à pousser les enseignants à prendre des responsabilités et du pouvoir. Seuls ceux qui souhaitent le progrès de l’école feront l’analyse inverse et prendront le risque d’une autorité négociée.
Où est l’évaluation dans tout cela ? Partout et nulle part. Elle devient une composante de la coopération, de la démarche de projet, de la réflexion et de l’analyse. Un acteur engagé dans une entreprise ambitieuse ne cesse de faire le point et d’introduire des régulations, y compris en travaillant au développement de ses propres compétences. Qu’il en ait alors conscience ou non, il dispense le système de régulations plus lourdes et autoritaires.
Trois dispositifs plus spécifiques
L’incitation à la professionnalisation interactive ne peut suffire. Il faut donc la compléter par des dispositifs plus spécifiquement orientés vers l’évaluation ou vers le contrôle des compétences. J’en distinguerai de trois espèces, complémentaires :
Les premiers sont pluriels, et peuvent tenir compte d’une certaines diversité, dans les limites des moyens et du temps disponibles. Le contrôle hiérarchique exige une plus grande unicité. Ce n’est pas le dispositif le plus sympathique et, dans le meilleur des mondes, l’efficacité des deux premiers rendrait son intervention presque exceptionnelle…
Ces divers types de dispositifs sont institutionnels, au sens où ils sont organisés, si possible conjointement, par la corporation professionnelle et le pouvoir organisateur, et où les enseignants ne sont pas libres de s’en dispenser. Cela signifie que la participation à ces divers dispositifs est inscrite dans le cahier des charges. Cela va de soi - du moins en théorie - pour le contrôle, mais ce devrait être vrai pour les deux précédents, qu’on considère souvent comme réservés aux volontaires. C’est dire que l’instauration de tels dispositifs est en soi un combat, qui n’a une chance d’être gagné que s’il y a alliance durable du pouvoir organisateur et de l’aile marchante de la profession, avec toutes les négociations voulues pour qu’une fois mis en place, de tels dispositifs fonctionnent avec le soutien des principaux acteurs. Développer l’évaluation des enseignants sans ou contre les organisation d’enseignants ne peut qu’aboutir à des faux-semblants ou à des crises.
Supervision et évaluation formative
Diverses modalités de supervision individuelle ou collective participent de la professionnalisation interactive. Je les isole ici pour les lier plus explicitement à une démarche d’évaluation formative.
Il s’agirait ici d’imposer la participation régulière à une forme ou une autre de dialogue formatif avec un visiteur sans pouvoir hiérarchique, mais qui serait dûment mandaté pour interviewer, observer, dire ce qu’il voit et entend, poser de bonnes questions, suggérer des pistes. Bref transposer à une relation d’adulte à adulte une démarche d’observation formative portant sur les compétences et les pratiques, dans un climat coopératif (St-Arnaud, 1992, 1995).
Le visiteur pourrait être un conseiller pédagogique ou un collègue enseignant qui joue ce rôle, sans cesser de tenir en parallèle sa propre classe. J’ai déjà souligné les limites de ce dispositif si on veut l’infléchir vers une évaluation certificative, avec des conséquences pour la notation, la progression dans la carrière ou divers avantages statutaires ou salariaux. Je crois en revanche que l’institution gagnerait à imposer l’existence et la qualité d’un tel dialogue, sans vouloir en contrôler le contenu ou les suites.
Dans le champ du travail social ou de l’éducation spécialisée, il y a longtemps que la supervision peut à la fois être imposée par contrat dans son principe et être réalisée d’une façon strictement confidentielle, sans aucune interférence avec les rapports quotidiens de travail, notamment les rapports hiérarchiques. Ce n’est pas du tout contradictoire, même si ce mode de faire est assez étranger à la culture des organisations scolaires.
Cela suppose évidemment la constitution, la formation, l’animation d’un corps de visiteurs. Les deux variantes statutaires ont des incidences différentes. On peut avancer par exemple l’hypothèse que des conseillers pédagogiques seront mieux formés en sciences de l’éducation, se sentiront moins identifiés aux praticiens, plus extérieurs, et moins liés par une solidarité de corps. Les visiteurs issus du corps enseignant et continuant à en faire partie auront une plus grande familiarité avec les ficelles du métier, partageront une culture professionnelle, créeront une relation moins asymétrique. On peut envisager une troisième voie : engager des superviseurs étrangers à l’organisation scolaire, dont ce serait la seule tâche. Cette formule, qui fonctionne dans le registre d’une supervision centrée sur l’identité et la relation, devient plus difficile lorsqu’il s’agit des compétences, car il faut alors que le superviseur soit fortement qualifié dans le champ de la pratique observée. Mais pourquoi ne pas envisager de mobiliser des enseignants n’exerçant plus le métier ou d’autres professionnel de l’éducation ?
Tout dépendra en fin de compte, autant que du statut, de la trajectoire personnelle des visiteurs et de l’esprit dans lequel ils font leur travail. Pourquoi faudrait-il choisir ? On peut imaginer qu’une partie des enseignants seront plus à l’aise avec des égaux, d’autres avec des conseillers pédagogiques exerçant clairement un autre métier. L’essentiel est que le dispositif soit au-dessus de tout soupçon et soit obsessionnellement confiné à des fonctions formatives, donc à une évaluation au service exclusif de l’évalué. La confidentialité ne nourrit pas alors la complaisance ou la complicité, bien au contraire. Elle autorise même une certaine tension, parce que le seul risque que court le praticien, c’est de se voir renvoyer une image de lui qui ne lui fait pas plaisir et d’entendre des suggestions qu’il peut ignorer, mais en sachant qu’il travaille contre lui-même.
Il s’ensuit, faut-il le dire, que les inspecteurs et les chefs d’établissement ne peuvent en aucun cas exercer une telle supervision, ni à ce titre, ni même en prenant une autre casquette. Il est même déconseillé de devenir conseiller pédagogique immédiatement après avoir exercé une fonction d’autorité, car on retrouvera difficilement la crédibilité requise. Les systèmes éducatifs qui, d’un jour à l’autre, débaptisent les inspecteurs pour les appeler conseillers pédagogiques ne rendent pas service à une fonction qui doit se définir, exclusivement, par une relation d’aide, fondée sur la coopération. Cela ne signifie pas que cette relation est constamment harmonieuse, mais qu’elle ne perd jamais de vue son but premier : être utile au " client ".
Audit et suivi d’établissements
L’évaluation des enseignants évoque encore aujourd’hui l’image d’une relation duale, une rencontre entre un observateur de passage et un enseignant observé. Peut-être est-il temps de rompre avec cette figure traditionnelle. À l’heure où on constitue les établissements en personnes morales et en acteurs collectifs, où on leur demande d’avoir un projet et de rendre des comptes sur son avancement, comment ne pas envisager de connexions entre l’évaluation des compétences et l’accompagnement de projets d’établissement ?
Le sort d’un projet d’établissement dépend, parmi d’autres facteurs, des compétences individuelles et collectives des enseignants impliqués. Concevoir, négocier, conduire un projet d’établissement et en rendre compte offrent à chacun l’occasion de se confronter aux pratiques des autres et de prendre la mesure soit de ses choix implicites, de ses limites et du rapport entre les premiers et les secondes.
Dans la mesure où le corps enseignant d’un établissement est solidairement engagé dans un projet, chacun devient dépendant des autres et a donc des attentes légitimes en termes de disponibilité, de force de travail, d’attitude, mais aussi de compétences apportées à la tâche collective ou dans le cadre d’une division équitable du travail. Le fonctionnement même d’un projet constitue donc un premier niveau de régulation des compétences, à la condition que l’institution rende la solidarité à la fois nécessaire et vivable, ce qui suppose sans doute un aménagement du statut des établissements.
Un second niveau de régulation apparaît dans le dialogue entre l’établissement et un interlocuteur externe, au stade de la genèse d’un projet aussi bien que de son évaluation après une ou plusieurs années. Cela suppose que les projets d’établissement aient un statut, s’inscrivent dans un contrat qui oblige les parties à négocier et aussi bien des ressources que des franchises, libertés accordées en dérogation de la règle commune.
Le problème se pose évidemment dans des termes différents selon que l’organisation scolaire prévoit ou non un chef d’établissement. S’il existe, il est préférable qu’il soit solidaire du projet ; il ne peut donc être en même son interlocuteur, même s’il est l’interlocuteur interne des équipes pédagogiques et du corps enseignant. L’interlocuteur d’un projet d’établissement peut être le responsable administratif d’une zone plus large, mais on peut envisager des formules différentes, par exemple une équipe d’accompagnement ou d’audit.
Dans le cadre de la rénovation de l’enseignement primaire à Genève, l’interlocuteur des écoles est un " groupe de recherche et d’innovation " (GRI) sans autorité hiérarchique, mais qui est garant d’un suivi du contrat passé entre les écoles et l’autorité scolaire. Ce groupe est composé pour l’essentiel d’enseignants s’investissant dans cette tâche à temps plein ou temps partiel.
Autre piste : dans l’académie de Lille, tous les établissements ont fait l’objet d’un audit, dans le cadre d’une démarche expérimentale (Demailly, 1996). Des équipes de quatre personnes ont été constituées : deux inspecteurs, un chef d’établissement et un formateur. Elles se sont organisées, dans le cadre d’un cahier des charges général, pour préparer, conduire, interpréter et restituer un audit, avec analyse de documents, visites dans les classes, entretiens, rencontres avec les groupes d’acteurs.
On peut imaginer d’autres dispositifs encore. L’important est, dans le contexte de l’évaluation des compétences, que le feed-back ne porte pas seulement sur le fonctionnement, le réalisme d’un projet ou l’écart entre le plan et sa réalisation, mais s’inscrive dans un bilan et une analyse des ressources humaines et propose une politique de formation faisant partie du projet d’établissement.
Un contrôle hiérarchique clairement assumé par les cadres
En dernière instance, si tout le reste ne suffit pas à assurer une régulation douce des compétences, il est légitime que l’autorité joue pleinement son rôle. Pour ce faire, il importerait que les inspecteurs sortent de l’ambiguïté assez générale que constate l’OCDE :
Lors de l’examen de ces différents mécanismes, il convient de relever le rôle ambigu des inspecteurs. Beaucoup d’entre eux s’efforcent de combiner une fonction de contrôle au rôle de conseiller pédagogique. Inspecter, c’est évaluer aux fins de gestion ou de contrôle. Donner des conseils, c’est rendre un service dont on peut ne pas tenir compte. La clarification du rôle des inspecteurs est une tâche toujours plus nécessaire. Leur compétence technique est un autre problème. La plupart d’entre eux sortent des rangs des enseignants les plus appréciés. Ils n’ont pas nécessairement une vue globale de l’éducation, ils ne saisissent peut-être pas la manière dont elle s’articule aux autres domaines de la politique sociale ni la contribution que les recherches pédagogiques peuvent apporter. De même, il leur arrive facilement d’adopter l’attitude d’un " amateur éclairé " vis-à-vis de l’évaluation. Or, ils doivent avoir une bonne maîtrise technique des différents modes d’évaluation ce qui implique la définition de critères, l’élaboration de méthodes appropriées de travail sur le terrain, l’aptitude à établir des rapports qui soient utilisables par ceux qui font l’objet des évaluations comme par ceux qui en sont les destinataires (OCDE, 1996, p. 42).
Les chefs d’établissements vivent, selon les traditions nationales, une semblable ambiguïté. Parfois leaders et animateurs pédagogiques, parfois gestionnaires sans responsabilité quant aux démarches didactiques des professeurs, les chefs d’établissement sont aussi en quête d’identité.
La problématique de l’évaluation et du contrôle des compétences n’est qu’un aspect du débat. Toutefois, aussi longtemps que les intéressés et les systèmes éducatifs n’auront pas opté clairement pour un rôle ou un autre, l’évaluation restera dans l’ambiguïté, elle aussi.
On ne peut trancher simplement d’un problème complexe, qui a partie liée avec la gestion des systèmes scolaires et de l’innovation. Je me limiterai donc à un postulat assez simple : les organisations scolaires doivent, d’une manière ou d’une autre, déléguer le contrôle des pratiques et des compétences de leurs salariés à des cadres dont c’est le travail, aussi inconfortable soit-il. À ceux qui ne souhaitent pas assumer cet inconfort, que l’institution propose d’autres voies, sans renoncer à la fonction elle-même et en ayant la sagesse d’y nommer des gens qui en assument la dimension d’évaluation. Il est souhaitable, une fois encore, que tout soit mis en place pour que le rapport d’autorité n’intervienne qu’en désespoir de cause et pour qu’il garantisse au mieux le droit et la dignité des personnes. Il reste à assumer pour une fraction minoritaire des enseignants une véritable tension, voire un conflit ouvert autour des compétences. Le droit d’être incompétent dans un poste de travail ne fait pas partie des droits de l’homme ! Ce dernier dispositif est en quelque sorte le fondement de tous les autres, il assure que l’absence de régulation et de formation ne restera pas sans conséquences.
Pour cela, on ne peut faire l’économie d’un réexamen du rôle des inspecteurs et des cadres, dans le sens d’une professionnalisation accrue, assortie d’une formation adéquate et d’une identité plus claire (Gather Thurler, 1996 b ; Perrenoud, 1994, 1996 g).
Entre statu quo et formule magique
Il serait bien illusoire de prétendre avoir fait le tour d’une question difficile, qui pose le problème de la norme, du pouvoir, de la liberté, de la responsabilité, de la gestion des organisations. Je ne suis pas certain que les dispositifs suggérés soient à la hauteur du défi, et ce ne sont certainement pas les seuls possibles. Il n’y a pas de formule magique et tout dispositif d’évaluation des compétences est au coeur des contradictions du système éducatif et plus globalement de la fonction publique aussi bien que du travail salarié.
Ces difficultés ne devraient pas dissuader de rechercher, par approximations successives, des formules viables et perfectibles. Une chose est sûre, en effet : le maintien du statu quo n’est pas favorable à la régulation des compétences professionnelles, donc à la professionnalisation du métier d’enseignant.
Les difficultés de la construction et de l’évaluation des compétences professionnelles des enseignants sont telles qu’elles peuvent décourager les plus convaincus. Affronter les difficultés relationnelles, éthiques et techniques de toute évaluation n’est déjà pas facile, et nul ne se précipite pour jouer ce rôle ingrat dans une société prompte à dénoncer l’abus de pouvoir ou la technocratie dès qu’on cherche à analyser de près l’efficacité du travail humain. À ces enjeux s’ajoutent les conflits qui se nouent inévitablement autour de la conception, de la mise en place et de la régulation de tout dispositif d’évaluation ou de contrôle. Ces conflits sont d’autant plus difficiles à surmonter durablement qu’il y a à la fois confusion quant au rôle de l’autorité, divergence sur les politiques de l’éducation et les figures modernes du métier d’enseignant, controverse sur les profils de compétences et les niveaux d’exigence et crise endémique de l’éducation scolaire…
S’il faut persévérer, ce n’est pas peur ajouter un problème, mais parce que la question des compétences et l’impuissance à les former et à les évaluer convenablement fait partie du problème. En ce sens, aller vers l’identification des compétences et leur régulation participe du mouvement vers des écoles efficace, vers l’émergence d’un praticiens réflexifs et d’établissements autonomes, bref vers la professionnalisation accrue des métiers de l’éducation,
Astolfi, J.-P. (1992) L’école pour apprendre, Paris, ESF.
Authier, M, et Lévy, P. (1996) Les arbres de connaissances, Paris, La Découverte.
Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. (1970) La reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris, Ed. de Minuit.
Cifali, M. (1994) Le lien éducatif : contre-jour psychanalytique, Paris, PUF.
Demailly, L. (1996) L’évaluation de l’établissement scolaire : analyse d’une expérience, Texte d’une communication au Symposium du REF, Montréal, 25-26 septembre 1996.
Demers, R. (1995) L’évaluation du rendement et de la compétence professionnelle : est-il possible d’innover dans ce domaine ?, La Revue des Échanges (AFIDES), Vol. 12, n° 1, pp. 6-10.
Develay, M. (1992) De l’apprentissage à l’enseignement, Paris, ESF.
Gather Thurler, M. (1994 a) L’efficacité des établissements ne se mesure pas : elle se construit, se négocie, se pratique et se vit, dans Crahay, M. (éd.) Problématique et méthodologie de l’évaluation des établissements de formation, Bruxelles, De Boeck, pp. 203-224.
Gather Thurler, M. (1994 b) Relations professionnelles et culture des établissements scolaires : au-delà du culte de l’individualisme ?, Revue française de pédagogie, octobre-novembre, n° 109, pp. 19-39.
Gather Thurler, M. (1996 a) Innovation et coopération entre enseignants : liens et limites, in Bonami, M. et Garant, M. (dir.), Systèmes scolaires et pilotage de l’innovation. Émergence et implantation du changement, Bruxelles, de Boeck, pp. 145-168.
Gather Thurler, M. (1996 b) Professionnaliser le métier de chef d’établissement : pourquoi et comment ?, La Revue des Échanges, vol. 13, n° 1, mars, pp. 1-16.
Huberman (1989 a) Survol d’une étude de la carrière des enseignants. Vais-je mourir debout au tableau noir une craie à la main ?, Journal de l’enseignement secondaire, n° 6, avril, pp. 5-8.
Huberman, M. (1989 b) La vie des enseignants. Évolution et bilan d’une profession, Neuchâtel et Paris, Delachaux & Niestlé.
Hutmacher, W. (1996) À qui rendre compte du travail des enseignants ?, L’Éducateur, n° 9, pp. 10-11.
Mazeran, M. (1995) Gestion et évaluation des personnels enseignants, La Revue des Échanges (AFIDES), Vol. 12, n° 1, pp. 2-13.
Meirieu, Ph. (1989) Apprendre… oui, mais comment ?, Paris, Ed. ESF, 4e éd.
Meirieu, Ph. (1990) L’école, mode d’emploi. Des méthodes actives à la pédagogie différenciée, Paris, Ed. ESF, 5e éd.
Meirieu, Ph. (1995) La pédagogie entre le dire et le faire, Paris, ESF.
Meirieu, Ph. (1996) Frankenstein pédagogue, Paris, ESF.
Miller, A. (1984) C’est pour ton bien. Racines de la violence dans l’éducation de l’enfant, Paris, Aubier Montaigne.
OCDE (1996) Évaluer et réformer les systèmes éducatifs, Paris, Organisation de coopération et de développement économique.
OCDE (1996) Qualifications et compétences dans l’enseignement technique et la formation professionnelle. Évaluation et certification, Paris, Organisation de coopération et de développement économique.
Perrenoud, Ph. (1992) Étrangler le dernier inspecteur ?, Éducateur, n° 20, décembre, pp. 4-5.
Perrenoud, Ph. (1994 a) Choisir et former des cadres pour un système éducatif plus décentralisé et plus participatif, La Revue des Échanges (AFIDES), Vol. 11, n° 4, pp. 3-7.
Perrenoud, Ph. (1994 b) La formation des enseignants entre théorie et pratique, Paris, L’Harmattan.
Perrenoud, Ph. (1994 c) Responsable, moi ?, Éducateur, n° 5, juin-juillet, pp. 6-9.
Perrenoud, Ph. (1995) La pédagogie à l’école des différences. Fragments d’une sociologie de l’échec, Paris, ESF.
Perrenoud, Ph. (1996 a) Formation continue et développement de compétences professionnelles, L’Éducateur, n° 9, pp. 28-33.
Perrenoud, Ph. (1996 b) L’évaluation des enseignants : entre une impossible obligation de résultats et une stérile obligation de procédure, L’Éducateur, n° 10, pp. 24-30.
Perrenoud, Ph. (1996 c) L’obligation de compétences : une évaluation en quête d’acteurs, L’Éducateur, n° 11, pp. 23-29.
Perrenoud, Ph. (1996 d) Rendre compte, oui, mais comment et à qui ?, L’Éducateur, n° 12, pp. 22-29.
Perrenoud, Ph. (1996 e) Le métier d’enseignant entre prolétarisation et professionnalisation : deux modèles du changement, Perspectives, vol XXVI, n° 3, sous presse.
Perrenoud, Ph. (1996 f) Enseigner : agir dans l’urgence, décider dans l’incertitude. Savoirs et compétences dans un métier complexe, Paris, ESF.
Perrenoud, Ph. (1996 g) Diriger en période de transformation ou de crise, n’est-ce pas, tout simplement, diriger ?, La Revue des Échanges (AFIDES), vol. 13, décembre, pp. 23-35.
Pion, N. (1995) L’évaluation des enseignants dans le réseau collégial : un modèle de politique, La Revue des Échanges (AFIDES), Vol. 12, n° 1, pp. 26-33.
Schön, D. (1994) Le praticien réflexif, Montréal, Éditions Logiques.
Schön, D. (éd.) (1996) Le tournant réflexif. Pratiques éducatives et études de cas, Montréal, Éditions Logiques.
St-Arnaud, Y. (1992) Connaître par l’action, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.
St-Arnaud, Y. (1995) L’interaction professionnelle. Efficacité et coopération, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.
Tardif, J. (1996) Le transfert de compétences analysé à travers la formation de professionnels, in Meirieu, Ph., Develay, M,. Durand, C. et Mariani, Y. (éd.) Le concept de transfert de connaissances en formation initiale et en formation continue, Lyon, CRDP, pp. 31-46.
Dix domaines de compétences reconnues
comme
prioritaires dans la formation continue
des enseignantes et des enseignants primaires
Les dix grands domaines de compétences qui suivent ne prétendent pas faire le tour du métier d’enseignant. Sans pour autant être exhaustif, le tableau répertorie les domaines sur lesquels un accent particulier est mis par le nouveau cahier des charges des enseignants, la rénovation de l’école primaire, la nouvelle formation initiale. À partir de ces domaines de compétences, des propositions de cours et de séminaires vous sont offertes, précisant les contenus disciplinaires et/ou transversaux.
|
de référence |
en formation continue (exemples) |
|
d’apprentissage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
technologies nouvelles |
|
|
|
|
|
|
|
|
de référence |
en formation continue (exemples) |
Genève, Enseignement primaire, Service du perfectionnement, 1996.
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1997/1997_01.html
Téléchargement d'une version Word au format RTF :
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1997/1997_01.rtf
© Philippe Perrenoud, Université de Genève.
Aucune reprise de ce document sur un site WEB ou dans une publication imprimée ne peut se faire sans l’accord écrit de l'auteur et d’un éventuel éditeur. Toute reprise doit mentionner la source originale et conserver l’intégralité du texte, notamment les références bibliographiques.
|
Autres textes : http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/textes.html Page d'accueil de Philippe Perrenoud : http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/ Laboratoire de recherche Innovation-Formation-Éducation - LIFE : |