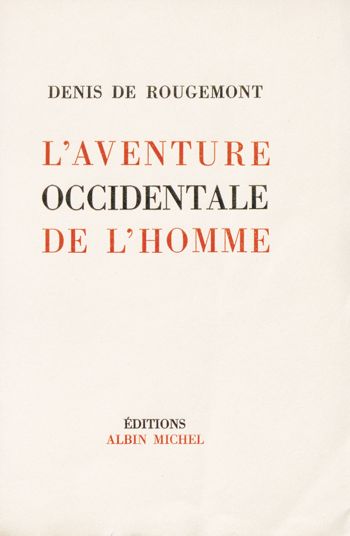L’Aventure occidentale de l’homme (1957)Lire
La civilisation occidentale a produit, entre autres, deux réalités bien spécifiques : la personne et la machine.
Notice
Partant d’une comparaison entre les figures du Bouddha et du Christ — le Bouddha quitte son palais et le monde, s’isole dans la méditation et la contemplation de l’Absolu ; tandis que le Dieu chrétien entre dans l’immanence, dans l’histoire, il prend le corps d’un homme et accepte la souffrance, puis la mort — Denis de Rougemont souligne le fait selon lui capital de l’Incarnation, qui aurait orienté toute la culture européenne et occidentale « vers la nature », vers un monde que l’homme est appelé non seulement à connaître, mais aussi à transformer par la science, par la technique. L’auteur revient tout d’abord sur les premiers grands conciles de l’ère chrétienne (Nicée, Chalcédoine), quand les dogmes de l’Incarnation et de la Trinité furent établis, inspirant la notion de personne. La personne constitue pour Rougemont l’« axe » principal d’interprétation de la trajectoire européenne et occidentale : elle fixe un but à atteindre — la communauté des hommes libres et responsables —, plus ou moins consciemment recherché par les sociétés successives, mais contrarié en permanence par les aléas de l’histoire. L’évolution du continent serait ainsi riche de ces « phases » où tour à tour dominent l’individualisme et le social, sans jamais vraiment réussir à créer un équilibre durable. S’ensuivent plusieurs chapitres où Rougemont tente de spécifier le rapport des Occidentaux à la Passion, à la Révolution, à la Nation ; mais aussi plus généralement au temps, à l’espace, à la matière, ou encore à la notion de progrès. L’ouvrage se conclue par un appel au dialogue métaphysique entre l’Orient et l’Occident, entre « l’Aventure » chrétienne occidentale et « la Voie » religieuse orientale.
Bibliographie
- Nicolas Stenger, « La Cité européenne, ou l’Europe idéale », Denis de Rougemont. Les intellectuels et l’Europe au xxe siècle, Rennes, PUR, 2015, p. 283-303.