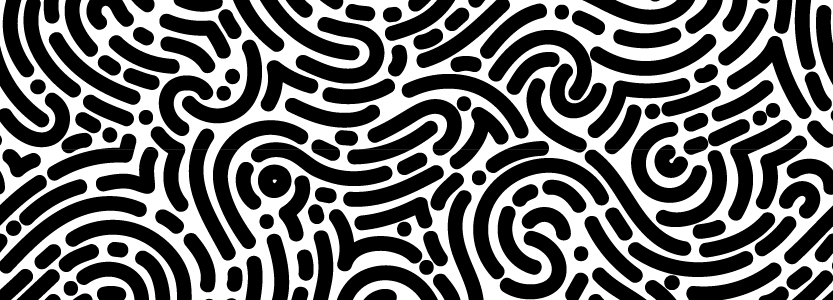Passer du singulier au pluriel
Béatrice Joyeux-Prunel
Du Close Up au panorama
Pour aborder les images à l’aune du « tournant global », il s’agit de changer d’échelle, du singulier au pluriel, de l’objet unique à la série, du close up au panorama. Tenter cette étude est le défi du projet Visual Contagions.
La masse des images en mondialisation est-elle ordonnée ? Y a-t-il des groupes d’images aux profils plus proches que d’autres ? Force est aussi de considérer qu’il n’y a pas une sorte d’image mais plusieurs, aux impacts potentiels très divers ; donc qu’un discours généralisé sur l’image serait naïf. Mais un flot d’images a peut-être des effets qui ne dépendent pas directement des images concernées : il faut un public aux images pour les consommer. Pas d’images, non plus, sans des mediums qui les rendent sensibles, matérielles. Les effets des images au pluriel sont-ils les mêmes sur un écran et sur un format papier ?
Etudier des images en grand nombre, c’est se confronter à bien plus que des visions du monde ; c’est toucher en même temps des sociétés très concrètes, avec leurs hiérarchies et leurs cloisonnements sociaux et culturels.
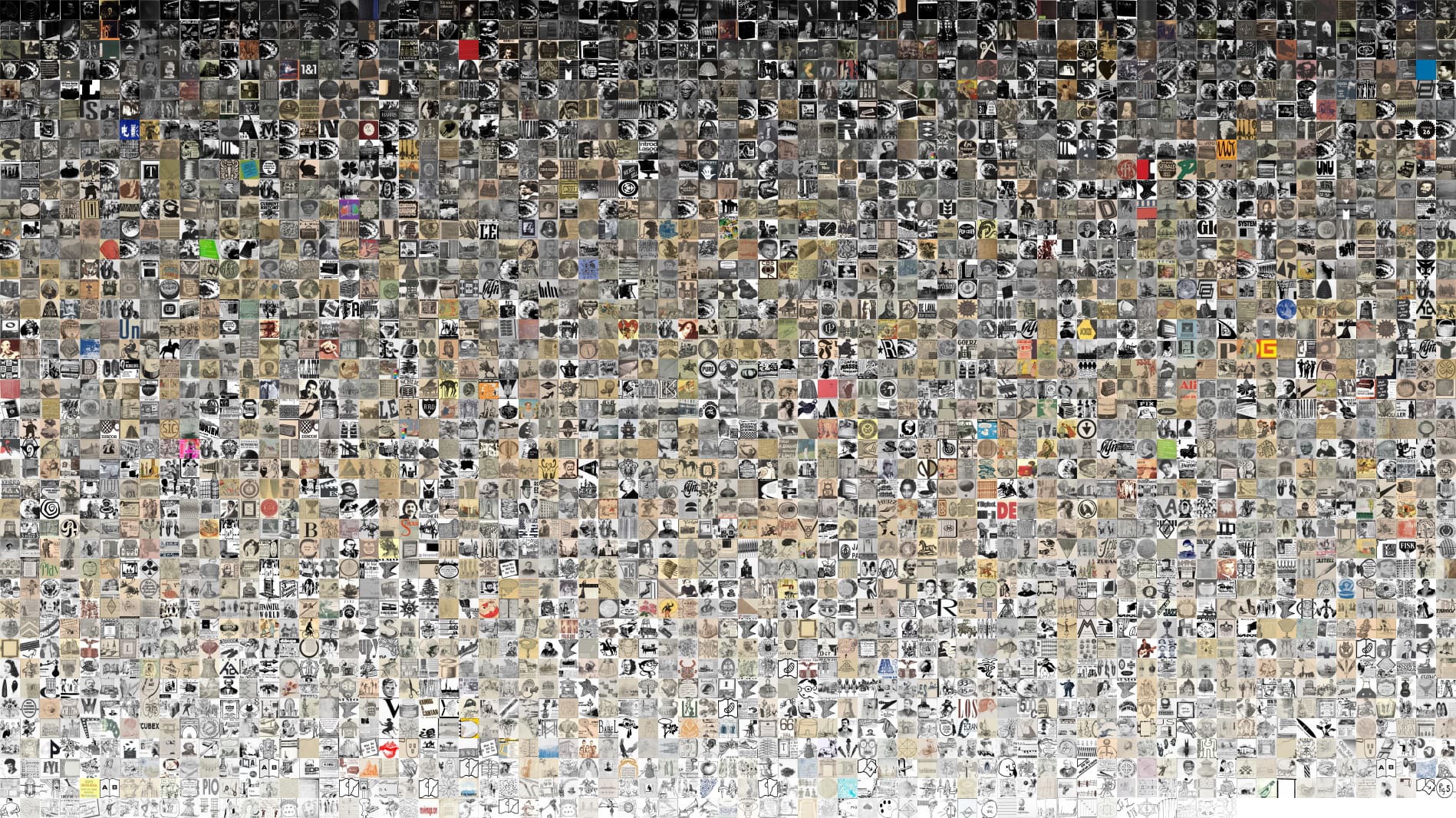
--
En illustration : 2500 images extraites aléatoirement du corpus d'imprimés illustrés du projet Visual Contagions.
Nous abordons le déluge mondial des images comme un flux, une circulation incessante dont la recherche doit donner des aperçus et comprendre les logiques.
Où transitent les images ? Quelles sont les infrastructures de leur circulation ? Pensons aux rotatives d’une imprimerie, aux lignes de train et d’avion, aux cris du vendeur de journaux, aux ondes hertziennes… Pas de flux sans possibilités économiques et politiques de circulation (droits ? frontières ?), ni sans une logistique qu’une théorie stricte de l’image ou même des images risque fort de manquer.
Héraclite plutôt que César
Aborder le déluge des images sous le prisme de leur circulation, c’est battre en brèche toute approche centraliste de la culture mondiale. C’est sortir des interprétations habituelles de la mondialisation en termes diffusionnistes et nationalistes.
Les historiens de la mondialisation ont constaté depuis longtemps que les objets culturels, pas plus voire encore moins que les personnes et les capitaux, ne respectent les frontières nationales[1]. Certains ont vu l’importance dans la circulation des objets culturels de leurs changements de sens, des réinterprétations qu’ils subissent, et des hybridations qui s’y trament. Ils ont ainsi défendu la capacité des régions considérées comme subalternes à s’approprier certaines formes (mythiques, narratives, littéraires, visuelles autant que pratiques, quotidiennes ou rituelles) et à en mettre en circulation de nouvelles. Ils ont insisté sur le rôle de la circulation des objets, des personnes, des idées et des œuvres dans une mondialisation beaucoup plus diverse que la caricature qu’on en fait souvent[2].
--
En illustration : le Globe terrestre, un des groupements d'images similaires les plus nombreux de notre corpus de périodiques illustrés.
Croiser cette inspiration avec l’histoire de l’art et les études visuelles n’était pas gagné d’avance. Car si l’histoire de l’art s’est toujours intéressée à la circulation des motifs et des styles, cet intérêt a longtemps été oblitéré par une conception nationale, voire nationaliste de l’art. Une conception hiérarchique des circulation artistiques y domine; César l’emporte sur Héraclite.
Le besoin systématique d’établir des palmarès et de justifier des admirations ne s’est pas perdu depuis les Vies de Giorgio Vasari, écrites pour illustrer la puissance de Florence (1550). L’intérêt ancien des historiens de l’art pour les diffusions d’images, de pratiques et de motifs, s’est le plus souvent concrétisé par des commentaires sur la domination artistique (voire spirituelle) de certaines villes, de certaines nations ou de certaines ethnies sur les autres. Ce que l’on appelle depuis le Moyen-âge la translatio imperii reste aujourd’hui un topos répandu dans les récits, les expositions et les publications même les plus sérieuses. Ce mythe du « transfert de l’empire » se fonde sur le récit sous-jacent du transfert au cours des siècles d’une domination mondiale sans partage : de Babylone à Athènes puis Rome, - puis, selon les époques et les chantres de l’idée, à Constantinople, à Ravenne, Florence, Rome, Paris, Londres, encore ou New York - la puissance économique et militaire de centres successifs aurait eu pour corollaire, voire pour préalable la migration d’une supériorité culturelle, religieuse, intellectuelle et spirituelle. Le mythe en question a été repris par bien des empires, du Saint Empire romain germanique au IIIe Reich. Il garde de beaux jours devant lui : on entend souvent que Paris aurait été la « capitale mondiale » de la modernité artistique jusqu’en 1945, et que New York aurait « volé » cette place depuis la Seconde Guerre ; plus récemment la Chine a mis en route un programme pour remplacer le « rêve américain » par le « rêve chinois », avec des justifications de type translatio imperii[3].
--
Lire la suite :
Pourquoi nous refusons toute idée centralisée de la mondialisation par l'image
Vers ce qui précède :
Iconophobie des iconodules
Retour au chapitre :
I. Face au déluge
[1] Michel Espagne, « La notion de transfert culturel », Revue Sciences/Lettres, 1 | 2013. URL : http://rsl.revues.org/219 ; DOI : 10.4000/rsl.219.
[2] Voir en particulier Arjun Appadurai, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot & Rivages, 2005 (Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, University of Minnesota Press, 1996).