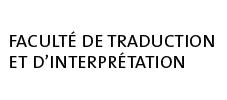Octobre 2019
Entretien
La parole à...Mathilde Fontanet

Mathilde Fontanet est professeure associée à la Faculté de traduction et d’interprétation. Depuis mi-juillet, elle est également codirectrice du Département de traduction et responsable de l’Unité de français. Après une première formation en lettres, elle a obtenu un diplôme de l’ETI (qui deviendra, en 2011, la FTI), puis a travaillé au CERN pendant une vingtaine d’années en tant que traductrice. Elle a commencé à enseigner la traduction au milieu de son parcours professionnel, puis s’est lancée dans la recherche en traductologie.
Professeure Fontanet, par quel chemin êtes-vous arrivée à la traduction ?
J’ai pris beaucoup de plaisir à étudier les littératures anglaise et allemande, mais l’obligation constante de parler et d’écrire dans des langues étrangères me pesait un peu. Le passage à la traduction a marqué pour moi un retour à la langue maternelle – le sentiment de revenir à la maison : j’étais sûre de trouver les mots justes et d’exprimer les nuances que je voulais.
À part le bonheur de travailler dans votre langue maternelle, qu’est-ce qui vous plaît dans le métier de traductrice ?
Toutes sortes de choses ! Tout d’abord, l’utilité. La communication humaine est complexe. Les approximations peuvent coûter cher : un courriel envoyé à la hâte peut déclencher une cascade de malentendus. On communique déjà souvent mal dans sa propre langue, alors dans une langue étrangère, mieux vaut s’adresser à des spécialistes… Traduire, c’est capter précisément ce qu’il faut transmettre, parfois en dépit des mots, et le présenter au destinataire sous la forme qui s’y prête le mieux : communiquer l’information, mais aussi gérer la relation. Une activité très noble, donc.
Et puis il est tout à fait jubilatoire de trouver des solutions. Parce qu’il nous arrive d’être confrontés à des difficultés invraisemblables ! Même s’il y a rarement une galerie de spectateurs pour nous applaudir, nos petits traits de génie nous procurent une forme d’exultation.
La recherche m’a aussi ouvert des perspectives très stimulantes. Aux colloques qui correspondent à mes intérêts, en lisant certains ouvrages de qualité ou en écrivant des articles, je peux entrer dans des questionnements plus fondamentaux.
Votre recherche porte sur les domaines de la traduction technique, scientifique et littéraire. N’est-ce pas un peu paradoxal ?
Peut-être bien. En fait, en traduction technique, la recherche se focalise plus sur des aspects pragmatiques : la gestion des difficultés, la didactique, la terminologie. La traduction scientifique, par sa portée démonstrative, fait aussi intervenir des éléments culturels et offre un champ de réflexion plus large. La vulgarisation scientifique est un domaine très intéressant, car ses enjeux sont multiples et elle peut être considérée sous la perspective de la didactique ou de la rhétorique. Le domaine de la traduction littéraire me semble le plus riche et le plus passionnant, car le texte peut y être analysé sous l’angle de ses aspects culturels, de l’intertextualité et d’une ribambelle d’effets formels.
Les références culturelles du texte source sont parfois un vrai casse-tête. Certains éléments culturels (appelés realia) sont propres à la culture source, sans avoir de pendant dans la culture cible. Il peut aussi exister une forme d’incompatibilité entre les deux cultures. Par exemple, dans un texte sur le Liberia que j’ai traduit, l’auteure, exilée, exprime une profonde nostalgie en songeant à une soupe dans laquelle mijotent des têtes de poisson et de la viande de chevreau. Et l’huile de palme y est présentée avec beaucoup de sensualité, comme une délicatesse aussi onctueuse que savoureuse. Comment faire saliver les lecteurs en évoquant ces mets ? Comment désamorcer les réactions négatives liées à des associations ou des habitudes bien ancrées ? La traductologie permet de s’intéresser à ces questions en prenant un certain recul.
Dans un article que je viens de publier, j’ai cherché à montrer que les notions de lecteur implicite (définie par Wolfgang Iser en 1976), de lecteur présumé et de lecteur empirique peuvent être mises à profit pour décrire les ajustements culturels à l’œuvre dans une traduction. Dans l’original, on trouve toujours des indices permettant de déduire quelles compétences et connaissances sont nécessaires à sa compréhension. Ces qualités sont celles du lecteur implicite. Selon moi, le traducteur ou la traductrice, en lisant l’original, mesure instinctivement l’écart de compétences encyclopédiques que présentent le lecteur implicite de l’original et le lecteur présumé de la traduction. Et c’est sur ce différentiel que vont se fonder les ajustements.
La voix qui émane d’un texte est un autre aspect qui me semble passionnant. Quand nous lisons une nouvelle, un roman ou un article, nous sommes sensibles à la voix qui y résonne. Mais comment cette voix prend-elle naissance ? Et quel est son écho dans la traduction ?
Parmi vos axes de recherche se trouve aussi le processus de traduction. Que pouvez-vous nous en dire ?
Plusieurs théoriciens se sont demandé quelles étaient les étapes de ce processus. Selon la théorie interprétative de l’école de Paris, il s’articule en trois phases : la captation du sens (explicite ou non) dans la langue source, la déverbalisation et la restitution dans la langue cible. Parmi d’autres, Christiane Nord a insisté sur le caractère non linéaire du processus. Selon elle, il est circulaire et implique de nombreux mouvements de rétroactions. Sur cette base, elle a élaboré un modèle beaucoup plus complexe. Tout comme elle, je ne suis pas sûre qu’il y ait une phase distincte de déverbalisation, qui nous permettrait d’aller à l’essentiel en dehors des langues ; je parlerais plutôt d’une phase de grand bouillonnement où tout entre en résonnance : les éléments du texte de départ, les images qui s’y associent, des a priori sur le texte et l’auteur, des mots de la langue source, d’autres de la langue cible (ou d’une langue tierce), et un vaste halo d’évocations qu’on ne maîtrise pas vraiment. Parallèlement, un processus de filtrage très efficace nous fait rejeter toutes sortes de solutions qui nous viennent à l’esprit.
On parle d’utiliser la traduction automatique dans le domaine littéraire. Quel est votre sentiment face à ce type d’évolution ?
Je vous parlais de voix : quand nous lisons une œuvre littéraire, nous n’y trouvons pas que le propos et la forme. Nous sommes accompagnés par « l’auteur », même s’il ne s’agit que d’une reconstruction que nous opérons, sans y penser, à partir du texte. Nous communions avec une présence subtile, cohérente, qui habite l’œuvre et que nous percevons partout, en filigrane. Et cela fait du bien à l’âme. Bien sûr, la traduction automatique peut vous offrir une version préalable à retravailler. Pourtant, même si des mots, peut-être même des phrases entières sont réutilisables, dans ce contexte précis, il me semble dangereux de manipuler des éclats de langue sans harmoniques, sans timbre ni écho. Personne n’aimerait lire un texte où s’entend une voix désincarnée, comme celle d’un GPS. Et j’ai peur que le passage par une première version inerte ne fasse obstacle à la créativité du traducteur. La traduction automatique produit des résultats impressionnants, mais il y a selon moi un risque à l’utiliser quand les dimensions humaines et émotionnelles sont au premier plan.