Trajectoires
Hommages 2024
Jasmin Hügi

Bibliothécaire système
Division de l’information scientifique
Jasmin Hügi a été bibliothécaire système dans l'équipe du Service de coordination de la Bibliothèque de l'UNIGE depuis 2018. Titulaire d'un Master of Science HES-SO en information documentaire, Jasmin Hügi a été auparavant assistante d'enseignement et de recherche à la Haute école de gestion de Genève, puis a travaillé plusieurs années comme bibliothécaire système au sein de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne où elle a notamment coordonné la migration vers le système de gestion de bibliothèque Alma. Son expertise et son professionnalisme ont largement contribué au succès du projet de migration de la Bibliothèque de l'UNIGE vers ce même système, en vue de son intégration dans la plateforme nationale swisscovery/SLSP.
Jasmin Hügi est décédée le 12 mars 2024 à l'âge de 38 ans. C'est toute une communauté professionnelle et d'ami-es qui est aujourd'hui attristée, avec une pensée particulière pour son conjoint, collègue du site Uni Mail, et ses enfants. Ses collègues conserveront de Jasmin le souvenir d'une personne pleine d'énergie, d'humeur toujours joyeuse et positive. Son rayonnement et la force de vie qui émanait d'elle resteront comme une source d'inspiration.
Jacques Montangero
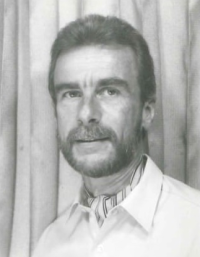
Professeur honoraire
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Professeur honoraire à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Jacques Montangero est décédé le 2 mars 2024. Après des études de lettres à l’Université de Lausanne, Jacques Montangero obtient une licence en 1961 avant d’enseigner au cycle d’orientation et au collège jusqu’en 1969, date à laquelle il reprend des études de psychologie.
Étudiant de Jean Piaget et de Bärbel Inhelder, Jacques Montangero soutient sa thèse de doctorat intitulée «Le double aspect ‘logique’ et ‘physique’ de la notion de durée» en 1974. Il est ensuite nommé maître-assistant et, un an plus tard, obtient une charge de cours en psychologie génétique, avant d’être nommé maître d’enseignement et de recherche en 1981. Son enseignement porte sur la psychogénèse des connaissances selon la théorie de Jean Piaget, ainsi que sur le développement de la connaissance du temps chez l'enfant de 8 à 12 ans.
De 1986 à 1993, Jacques Montangero dirige la Fondation Archives Jean Piaget. Il est responsable du premier volet de l’exposition consacrée à Jean Piaget (1995-1996).
En 1987, il est nommé professeur adjoint. En 1996, il reçoit le titre de Docteur honoris causa de l’Université de Coimbra (Portugal). Il devient professeur ordinaire en 1998 et le restera jusqu’à son départ à la retraite en 2002. Durant sa carrière, Jacques Montangero a été professeur invité aux Universités de Bruxelles, Lausanne, Fribourg ainsi qu’à la Graduate School de la City University of New York.
Dans le cadre de ses recherches, Jacques Montangero se spécialise dans l’enseignement de la théorie de Jean Piaget sur le développement des connaissances chez l’enfant, puis sur l’évolution des modèles piagétiens. Dès 1985, il s’intéresse aux aspects cognitifs du rêve, un intérêt qu’il conservera jusqu’à la fin de sa carrière universitaire. Il se forme à la psychothérapie cognitivo-comportementale, étudie le processus d’élaboration des rêves, les spécificités des représentations oniriques, ainsi que les aspects narratifs du rêve.
Tout au long de sa carrière académique, Jacques Montangero a également développé une importante activité associative. Il a été membre de plusieurs associations suisses et internationales, comme le groupe de recherche international TAC (Time, action and cognition), l’Association for the Study of Dreams, l’International Society for the Study of Behavioral Development, la Société suisse de psychologie ou l’Association de psychologie scientifique de langue française.
Martin Stettler

Professeur honoraire
Faculté de droit
Professeur honoraire à la Faculté de droit et ancien vice-Recteur de l’Université, Martin Stettler est décédé le 20 décembre 2023 à l’âge de 83 ans. Après des études de droit à l’Université de Genève entamées en 1971, il y obtient un doctorat en 1979. Chargé d’enseignement, puis chargé de cours, il est nommé professeur ordinaire dès 1983. Il dirige alors le Département de droit civil, enseigne le droit des personnes et de la famille, ainsi que le droit des régimes matrimoniaux et celui des successions. Il exerce en outre la fonction de vice-recteur de l’Université, de 1987 à 1991, puis celle de doyen de la Faculté de droit, de 1993 à 1997.
Avant son parcours universitaire, Martin Stettler effectue un apprentissage agricole, puis il obtient en cours d’emploi le diplôme d’assistant social en 1968. De 1964 à 1970, il travaille comme assistant social dans le secteur de l’exécution des peines privatives de liberté auprès de l’État de Vaud, tout en poursuivant le gymnase du soir. Puis, en parallèle de ses études universitaires, il devient directeur adjoint du Service de protection de la jeunesse à l’État de Genève en 1973, assumant la direction de ce service de 1974 à 1980, année où il devient secrétaire adjoint au Département de l’instruction publique, chargé des affaires universitaires.
Tout au long de sa carrière académique, Martin Stettler contribue au développement et au rayonnement suisse et international de l’Université de Genève, notamment à travers ses engagements en faveur de la protection de l’enfance tant en matière civile que pénale. Il assume plusieurs mandats d’expert, nommé par le Conseil fédéral pour participer à l’élaboration de textes légaux, dont la révision du droit pénal des mineurs et la révision du droit de la tutelle, ainsi que comme délégué au Congrès de l’Association internationale des magistrats de la Jeunesse à Rio de Janeiro en août 1986.
Michelangelo Foti

Professeur ordinaire
Faculté de médecine
Après ses études de biochimie à l’Université de Genève, Michelangelo Foti obtient en 1996 un doctorat ès sciences pour un travail sur la biologie des récepteurs cellulaires pour le VIH. En 1999, il effectue un séjour post-doctoral à l’Université de San Diego pendant lequel il acquiert une expertise en microscopie électronique. Fort de son expérience, il rejoint en 2001 la Faculté de médecine de l’UNIGE, où il développe un axe de recherche dans le domaine des maladies métaboliques et des cancers associés à l’obésité. Il devient un chercheur de haut niveau reconnu par ses pairs dans le domaine des hépatopathies stéatosiques non alcooliques et de leur progression vers un carcinome hépatocellulaire. Il est également membre des Centres facultaires du diabète et de la recherche translationnelle en onco-hématologie.
Sur le plan académique, Michelangelo Foti est nommé privat-docent de la Faculté de médecine en 2010, puis professeur associé au Département de physiologie cellulaire et métabolisme en 2012, et enfin professeur ordinaire en 2021. Il était également le responsable académique du pôle de microscopie ultrastructurale. Très impliqué dans l’enseignement, qui était pour lui un devoir fondamental, il a été responsable de l’unité «Digestion et métabolisme» en 2ème année de médecine.
Également très actif dans la vie universitaire, Michelangelo Foti est membre du Conseil participatif de la Faculté de médecine depuis 2005, et a occupé la position de directeur du Département de physiologie cellulaire et métabolisme de 2018 à 2022. En 2023, Michelangelo Foti est élu président de la Section de médecine fondamentale de la Faculté de médecine. Ses priorités au cours des derniers mois ont été de mener des réflexions sur l’amélioration de l’enseignement, et d’œuvrer à l’équité dans l’attribution des ressources pour les laboratoires de recherche.
D’un caractère positif et entier, Michelangelo Foti était estimé et apprécié par ses collègues pour ses qualités personnelles alliant franchise et bonne humeur, mais aussi pour son profond respect de la démocratie, son écoute et la transparence de ses actes. Enthousiaste de tout et plein d’énergie, il nous quitte bien trop tôt, et laisse un vide immense à sa famille, ses amis, et ses collègues, tous sous le choc d’un départ prématuré. Nous chérirons le souvenir de son amour de la vie et de son amitié sincère. Michelangelo Foti est décédé le 11 décembre 2023.
